Annales archéologiques dirigées par
Didron Ainé, tome 6ème, Paris, 1847 pp 71-88.
ARCHITECTURE CIVILE AU MOYEN AGE
DANS LE
PÉRIGORD ET LE: LIMOUSIN.
·
Plan de la ville de Montpazier
·
Façade de la maison du chapitre à
Montpazier
·
Plan de la ville de Beaumont
En fait
de villes du moyen âge, je n'ai parlé, jusqu'à présent[1] , que du plus grand nombre, c’est-à-dire
des cités romaines qui se sont lentement relevées de leurs ruines au xe
et au xie siècles, et des villes secondaires qui se sont formées
vers la même époque autour d'une abbaye ou d'un château. Les unes et les autres
ont pris leur forme et leur plan dans des temps encore malheureux, au milieu de
difficultés inouïes, et, une fois nées, elles ont grandi avec leurs difformités
originelles que l'on a vainement tenté de corriger. Mais ce n'est pas d'après
de telles villes qu'il faut juger le moyen âge.
Il en est d'autres moins importantes
et moins nombreuses assurément, moins riches en belles constructions, qui
néanmoins révèlent, bien mieux ses véritables goûts, ses véritables tendances.
Je veux parler des villes neuves bâties
tout d'un coup, en une seule fois, sous l'empire d'une seule volonté. Comme on
n'en a rien dit dans les ouvrages consacrés à l'architecture civile du moyen
âge, on croit sans doute que ces villes ressemblent aux autres; rien n'est plus
faux, et l'ordre chronologique: que j'ai voulu garder fidèlement m'amène enfin
à combattre cette erreur.
Dans la seconde moitié du xiiie siècle, temps de
paix et de prospérité, un petit coin de l'une des provinces, que j'étudie
spécialement, se couvrit rapidement de ces villes neuves appelées bastides dans l'ancienne langue du
Midi: Voici par quelles circonstances. Alphonse de Poitiers, frère de saint
Louis, était devenu, par son mariage avec l'héritière des comtes de Toulouse,
le seigneur nominal d'une partie de la Guienne; mais il n'avait que peu de
prise sur ces contrées, et sa souveraineté se réduisait souvent à leur simple
titre. Dans le Rouergue, notamment, il avait bien hérité de la suzeraineté des
derniers comtes de Toulouse; mais le bourg de Rodez, vendu par Raymond IV en
1095, appartenait aux comtes de ce nom, et la cité à l'évoque.
Toutes les localités importantes avaient de même un maître particulier,
qui se bornait à lui rendre hommage. Il voulut une autorité plus directe, plus
positive, et, pour se créer une capitale, il fit bâtir Villefranche de Rouergue
dans l'Agenais, il fonda, par des motifs analogues, la ville importante de Villeneuve
d'Agen et plusieurs bourgs moins considérables. Dans le Périgord, où il avait
quelques possessions, il fonda aussi des bastides.
« En 1259, par un traité daté du 1er mars, Élie,
abbé de Cadouin, seigneur pour les deux tiers des forêts et terres cultivées ou
incultes de Castillonnès, et les frères Bertrand et Arnaud de Mons,
propriétaires du troisième tiers, conviennent de céder gratuitement ces
terrains au sénéchal d'Agen, pour y bâtir une ville dans les limites et selon
l'indication qu'en feront Pons Maynard et Gautier, ingénieurs à Monflanquin. Les trois donateurs se réservent de
bâtir trois maisons à leur usage. ».[2]
Vers la même époque, le comte de Poitiers se
fit offrir par Bertrand de Pestilhac une terre assise près de l'église de
Notre-Dame de Vieil-Sciorac, et aussitôt les procureurs du sénéchal jetèrent
les.fondements d'une bastide qui fut Villefranche de Périgord[3]. En
1270, le même prince érigea en ville une petite baronnie du nom d'Eymet, et
accorda aux habitants les privilèges dont jouissaient Bordeaux, Bergerac et
Périgueux [4].
Voici comment se passaient les choses
dans, la plupart de ces fondations de ville. Le
prince se faisait donner par une abbaye ou par un pauvre chevalier
l'emplacement choisi par son sénéchal. Il y faisait tracer des rues et invitait
simplement les populations à s'y établir. Quelques seigneurs se faisaient
rendre leurs hommes; En Rouergue, l’évêque excommuniait, sans balancer,
quiconque faisait concurrence à sa cité de Rodez en bâtissant des maisons à
Villefranche[5]. Malgré cette opposition,
chaque nouvelle ville se remplissait d’habitants, sans grande dépense pour le
prince.: Il accordait tout au plus le droit de prendre du bois dans
ses forêts, des pierres dans ses carrières, et prodiguait surtout les
privilèges et les chartes de commune.
D'autres princes avaient sans doute donné l'exemple à
Alphonse de Poitiers; il le donna certainement dans nos contrées aux rois de
France et d'Angleterre. A Domme, par exemple, il existait une tour et quelques
maisons sur une colline baignée par la Dordogne, Philippe-le-Hardi la fit
acheter par Simon de Mellondino, sénéchal, pour 500 livres de tournois noirs.
En 1280, le grand sénéchal de Normandie fut député pour dessiner l'enceinte
d'une ville. Il fit dresser une batterie de monnaies menues pour payer les
ouvriers et manœuvres; et, la ville construite, le roi accorda toutes sortes de
privilèges. Les habitants auront droit de collège et de communauté, avec
puissance de créer des consuls ; droit de four et de moulin ; ils seront
exempts de tailles, péages, et paieront seulement six deniers au roi par
emplacement ou par eyrial. La ville sera toujours du domaine royal, sans
pouvoir être démembrée. Il y aura cour et justice royale, cour du petit sceau,
cour du sénéchal, etc. (Bordeaux, 1283; Auch, 1285.) J'emprunte ces curieux
détails au travail de M. de Gourgue, pour montrer combien le roi de France
tenait à multiplier les villes qui, telles que Périgueux et Sarlat, mettaient
leur honneur à ne relever que de lui. Au reste, dès 1263, l'attention des
vicomtes de Gourdon et de Turenne était éveillée sur les projets de la cour de
France, car ils obtenaient de saint Louis la promesse qu'il ne fonderait aucune
ville neuve enclavée dans leurs terres. — « Non faciemus bastidas aliquas de
novo infra fines terrae quam habet idem vicecomes[6]».
De son côté, Edouard Ier, d'abord comme duc et
bientôt comme roi, multiplia singulièrement les fondations de ce genre ; et
c'est un des meilleurs titres de ce grand prince au souvenir reconnaissant de
l'ancien duché de Guienne. Libourne, entre autres, lui doit son existence
(1286). Mais les plus grandes de ces villes ne sont pas les plus anciennes ni
les plus curieuses. — Ces dernières se pressent dans le bas Périgord, sur la
frontière des possessions anglaises.
En 1272, Lucas de Terny se fit donner par le seigneur de Biron, le prieur
de Saint-Avit et l'abbé de Cadouin, le terrain où l'on construisit Beaumont pour
le compte du roi d'Angleterre[7].
Un an avant qu'on ne travaillât à
Beaumont, et à quatre lieues au nord de cette localité, le maréchal Jean de La
Linde commença sur son propre domaine la bastide de La Linde, le 26 juin de la
cinquante-unième année du règne de Henri III. Le 7 janvier 1284, P. de Gontaut, baron de Biron,
donna au sénéchal Jean de Grailly, qui lui promit de l'en récompenser, un lieu
désert près d'une forêt, à quatre lieues au nord de Beaumont. On y bâtit
Montpazier [8].
Je passe, pour y revenir bientôt, d'autres fondations
pareilles dont la date n'est pas aussi bien connue, mais dont l'origine n'est
pas douteuse. Quoi qu'il en soit, dans les premières années du xive
siècle, le roi d'Angleterre ne fondait plus de nouvelles bastides; mais il réunissait
à sa couronne la plupart de celles de l'Agenais et du Périgord, comme
l'attestent les Rôles gascons. Au milieu du même siècle, il les donnait, au
contraire, aux seigneurs gascons de son parti[9].
La politique anglaise était changée; elle
ne comptait plus que sur les armes pour conserver l'héritage des anciens ducs
d'Aquitaine, et renonçait à tous les moyens pacifiques. Dès lors plus de
nouvelles bastides, ce qui fixe encore mieux la date de celles dont il s'agit.
— J'en ferai connaître en détail quelques-unes des plus remarquables et des
mieux conservées, et ce sera, je pense, un excellent moyen de réhabiliter
l'architecture civile du xiiie siècle.
MONTPAZIER.
Voici d'abord le plan de Montpazier[10] plan
tracé en 1284 et qui n'a point été altéré depuis. Cette petite ville, située
sur un plateau très-élevé que domine, à l'horizon, la masse imposante du
château de Biron, se présente sous la forme d'un parallélogramme rectangle de
400 mètres de longueur et de 220 mètres de largeur. Elle n'avait point de
fossés à cause de sa situation, mais seulement un mur flanqué de tours carrées;
point de pont-levis, mais seulement des portes de bois, précédées et suivies de
herses. Au nord et au sud, sur les petits côtés du parallélogramme, les murs
subsistent presque intégralement; mais je ne donne qu'une moitié de la ville
avec la place centrale. A l'est et à l'ouest, l'enceinte est au contraire
entièrement détruite et je n'ai pu, par cette raison, arrêter mon plan sur les
côtés. Je me suis cependant assuré que la ville s'étendait un peu plus à l'est
que du côté opposé où le plateau se terminait plus brusquement. Je n'ai indiqué
qu'autour de la place l'état actuel des maisons, mais partout leur arrangement
primitif s'est conservé au moins aussi bien. Tel qu'on le publie, le plan de
Montpazier n'en suffit pas moins à donner parfaitement idée de l'œuvre de Jean
de Grailly. Quelle régularité ! On dirait le plan d'un potager et non pas celui
d'une ville. Quatre grandes rues de même largeur se croisent au centre de la
ville et laissent entre elles un espace libre; qui forme le marché, la place
publique, le forum en miniature de la petite cité. Au lieu de faire façade en
arrière des rues, les maisons, au nombre de vingt-deux, qui bordent la, place,
s'avancent portées sur de larges ogives et ouvrent à la voie publique, un
passage couvert où deux chariots peuvent facilement se croiser (six mètres). Le
long de la place centrale, les rues sont donc couvertes par les maisons; elles
offrent aux habitants un abri contre le soleil et contre la pluie. Ces galeries
ne .sont pas, il est vrai, aussi élégantes que celles de la rue de Rivoli, mais
du moins elles sont assez profondes pour que le soleil y laisse un peu d'ombre
et pour que le vent n'y fouette pas la pluie trop avant. Au moment même où je
relevais le plan de Montpazier, des charrettes chargées de foin s'y étaient
réfugiées; des chevaux s'y trouvaient attachés aux anneaux de fer dont les
piliers sont pourvus, et la, circulation, n'était point interrompue. Il y a
bien dans tout cela un certain cachet de bizarrerie; mais c'est original, c'est
pittoresque et surtout c'est commode.
La place, étant interdite aux voitures, est plantée d'arbres,
et j'imagine qu'il en a toujours été de même. La halle, simple hangar soutenu
par vingt-huit piliers de pierre, s'y trouve placée, non pas au centre, mais
près d'un des côtés. La maison commune devait s'y trouver aussi, mais elle a
été rebâtie ou est devenue méconnaissable.
Comme, les maisons qui entourent la place couvrent exactement
les rues, elles se rejoignent par leurs angles au moins à leur étage supérieur
; mais, au rez-de-chaussée, on a pu, au moyen d'encorbellements, abattre, ces
angles, de sorte que l'on débouche directement dans l'espace réservé, par des
passages obliques de 1m 65. Rien de pittoresque et aussi de
singulier comme cet arrangement que le croquis ci-joint fera parfaitement
comprendre, ainsi que la physionomie de ces rues couvertes, sous lesquelles le
regard s'étend jusqu'aux portes de la ville.
Les encorbellements des angles de la place changent de forme
et de hauteur presque à chaque maison, parce qu'on a laissé à chacun là liberté
de varier selon son goût les détails de construction et les rares ornements de
sa demeure. A cela près, rien dans cette ville de Montpazier n'a été donné à la
fantaisie. — Toutes les rues sont tracées au cordeau et parfaitement droites. —
Toutes se coupent à angles droits. — Toutes ont des dimensions déterminées
selon leur importance. Ainsi, les quatre grandes rues, qui sont les principales
artères de la ville, ont 8 mètres de largeur, justement comme nos routes
départementales. Les autres ont 7m 50 et 5m 65, selon
qu'elles se trouvent dans la longueur ou dans la largeur de la ville. Bien
plus, on a mesuré rigoureusement sa place à chaque maison, et certes nous n'en
sommes pas encore là, malgré notre manie de régularité. — L'homme qui a tracé
sur le terrain le plan de Montpazier, comme un architecte trace celui d'un
édifice, calculait tout, de manière à loger dans un espace donné le plus grand
nombre possible d'habitants et à les loger le plus commodément possible. Il fit
donc en sorte que toutes les maisons présentassent leur pignon sur une rue et
qu'elles aboutissent par leur autre extrémité à une voie d'un ordre secondaire,
à une ruelle; de cette manière point de cours, point de jardins, mais aussi
point de terrain perdu. Ces ruelles ont 2m30, lorsque, partageant en
deux l'intervalle compris entre les rues, elles courent d'un bout à l'autre de
la ville ; 2 mètres seulement derrière les maisons des petits côtés de la
place.
La profondeur des emplacements se trouvait réglée à 19 mètres.
L'ingénieur n'eut plus qu'à fixer leur largeur, qui est de 8 mètres environ ou,
plus exactement encore, de 24 pieds[11],
l'espace que peuvent couvrir des solives de moyenne, grandeur. — Il y avait peu
d'inégalité parmi les premiers habitants de Montpazier; on s'accommoda donc
sans peine de ce partage, et rarement il arriva qu'une seule maison s'étendît
sur deux emplacements. C'est probablement par la même raison que, lors de la
fondation de Domme, on put supprimer tous les impôts en usage dans ce temps et
les remplacer par une taxe uniforme de quelques deniers par eyrial ou par
emplacement.
Pour que
chaque maison pût s'emparer de tout le terrain qui lui avait été attribué, il
aurait fallu, puisque l'on se servait de toitures à pignons sur rue, recevoir
les eaux pluviales dans les rigoles placées sur les murs mitoyens. Mais c'était
cher, c'était même d'une construction difficile, à cause de la profondeur
excessive des emplacements. On préféra pourvoir toutes les maisons de leurs
quatre murs et laisser entre chacune d'elles un étroit intervalle de 0m25
à 0m35. On ne savait donc pas, dans le vieux Montpazier, ce que
c'était qu'un rnur mitoyen. Chaque maison était isolée et formait une insula,
ce qui empêchait les incendies de faire de grands ravages. Toutefois, car
il faut tout dire, ces intervalles, que je ne sais comment nommer, sont
habituellement assez malpropres, quoique les eaux s'en écoulent sans
difficulté.
Comme la
ville de Montpazier se trouve en quelque sorte orientée, l'église n'a dérangé
en rien la régularité ni l'harmonie de son plan. C'est d'ailleurs une
construction peu remarquable, quoiqu'elle appartienne dans son ensemble à la
fin du xiiie siècle. Elle était régulière, avant qu'on n'eût bâti de
petites chapelles entre ses contreforts, et convenablement spacieuse; mais son
style est mauvais, et l'on s'en apercevrait rien qu'à considérer sur le plan
l'arrangement bizarre des nervures du chœur.
On ne rencontre point à Montpazier de belles maisons, ce qui
est tout simple, car les gens qui peuplaient ces bastides n'avaient point de
fortune acquise qui leur permît de bien décorer leur demeure. En revanche, on
trouve en très-grand nombre les maisons de pacotille, si je puis m'exprimer
ainsi, qui remontent à la fondation de la ville. Bâties en pierre de taille, à
cause de la commodité des carrières, elles n'ont pas cessé d'être habitables;
mais elles ont perdu généralement leur toiture primitive, leurs cheminées et la
plupart de leurs fenêtres.
Une
seule maison m'a paru mériter une description particulière. On l’appelle la
maison ou le grenier du chapitre; et en effet, depuis très-longtemps, elle ne sert
plus que de grenier, quoique dans l'origine elle ait été certainement destinée
à être habitée. En voici la distribution au rez-de-chaussée, que j'avais déjà
indiquée sur le plan général de la ville, mais que je reproduis à une plus
grande échelle, par ce motif qu'il est extrêmement rare de trouver des maisons
du xiiie siècle dont la disposition intérieure n'ait été altérée en
aucune façon.
MAISON DU CHAPITRE, XIIIe ET XIVe
SIÈCLES, A MONTPAZIER.

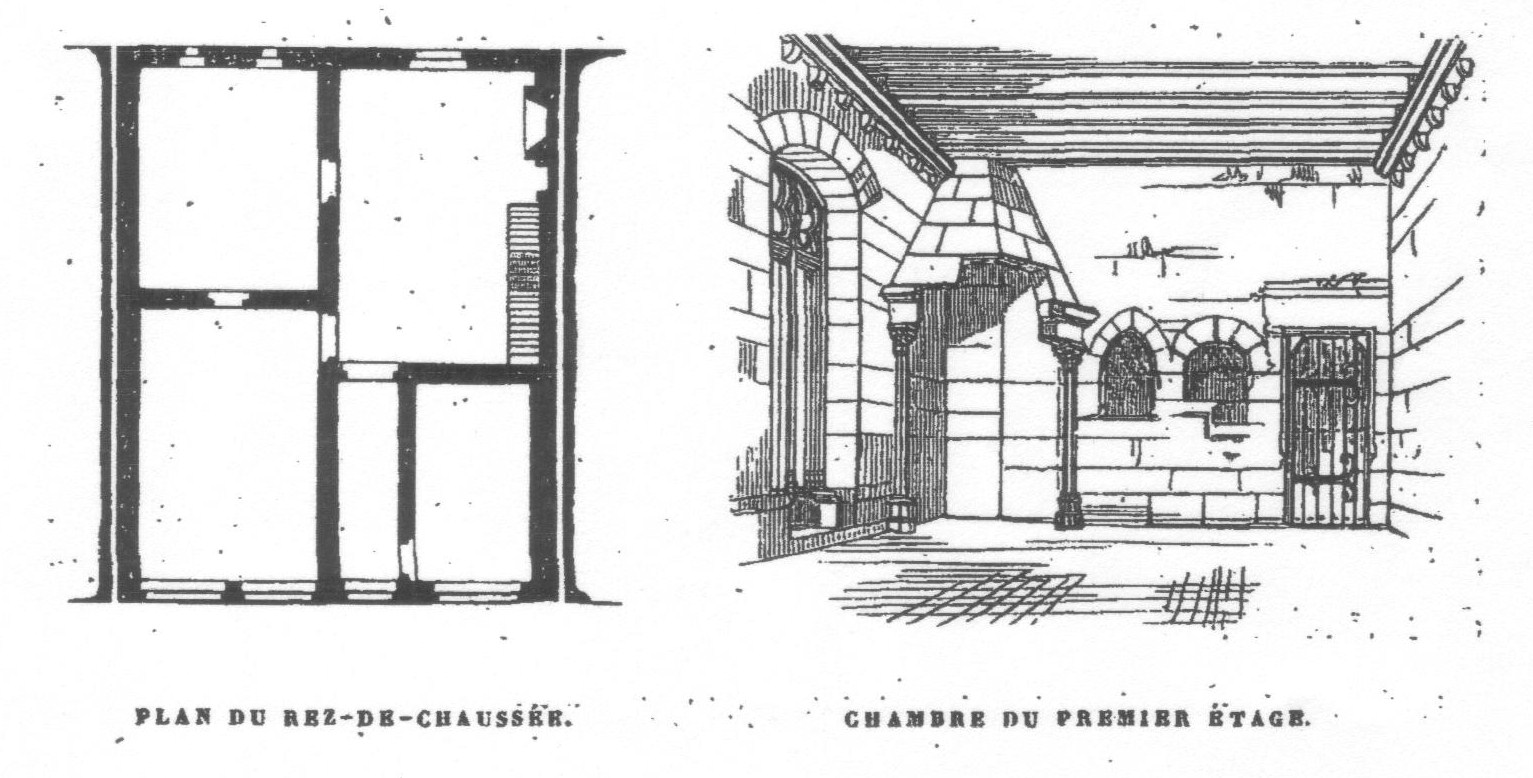
On a vu, sur le plan de la ville, que la maison est double et qu'elle
occupe deux emplacements ordinaires. La première moitié offre deux pièces dont
l'une semble avoir servi de boutique. La deuxième offre également une boutique
plus petite qui s'ouvre sur la rue par une ogive de 2m 95 ; un large
corridor aboutissant à une arcade plus étroite; puis, une grande pièce servant
sans doute de cuisine, avec une vaste cheminée, un évier, et un escalier en
pierre assez semblable à ceux d'Aigues-Mortes[12].
Cette seconde moitié paraît avoir été ajoutée après coup, quoiqu'elle soit
parfaitement liée à l'autre et qu'elle contienne à présent l'escalier qui
conduit aux quatre pièces de l'étage supérieur ; mais elle l'aurait été à un
très-court intervalle. Cela est surtout apparent sur la façade que je donne
ci-contre, dans l'état de ruine et d'abandon où elle se trouve.
Un des premiers et des principaux habitants de
Montpazier, quelque marchand sans doute, ayant augmenté son aisance, aura agrandi
sa maison. De là, je pense, ce changement de dessin et cette légère différence
de style.— Plus tard, le chapitre aura acquis cette habitation et en aura fait
un grenier; mais il me semble impossible, malgré le voisinage de l'église,
qu'il s'y soit jamais logé.
J'ai remarqué dans les étages supérieurs une chambre à coucher, la
chambre d'honneur certainement, dont la vue est donnée ici et touche au plan. .
La fenêtre, dont les moulures ne sont nullement prismatiques, avait, avant
d'être mutilée, cette forme originale. Elle était en croix, avec deux
quatrefeuilles au-dessus des croisillons. La cheminée placée dans l'angle n'est
pas moins contraire aux précédents ; elle est pentagonale. A défaut d'art et de
style, les maçons du moyen âge avaient donc toujours, l'imagination qui fait
trouver des formes nouvelles et la liberté d'esprit qui permet de les essayer.
—- On observera que les solives du plafond ne sont pas engagées dans les murs,
mais qu'elles reposent sur deux autres pièces de bois, soutenues elles-mêmes
par des corbeaux en pierre. Cet arrangement est ordinaire dans les maisons du
moyen âge, tout comme les bancs en pierre et l'amortissement en arc surbaissé
de la fenêtre. Cette petite ogive, à côté de la cheminée, c'est une armoire
avec la feuillure de ses battants et les rainures de ses rayons. Ce
plein-cintre, c'est un évier tout usé par les vases qu'on y déposait. Cette
porte carrée, c'est l'entrée d'un étroit couloir pratiqué, à l'aide d'un
encorbellement, dans l'épaisseur du mur qui conduit à des latrines. Voilà le
confort quelque peu primitif d'une chambre à coucher du xive siècle.
Que de choses à dire sur une bourgade du Périgord! Je termine en
réclamant, à tout événement, que l'on apporte à l'avenir un peu plus de soin
dans la conservation du plan de Montpazier. On ne s'est pas encore avisé
d'élargir les rues ou de les rétrécir, mais on souffre que plusieurs d'entre
elles soient envahies ou condamnées. Depuis la révolution, on s'est empressé de
démolir les portes de la ville qui étaient fort nombreuses, car le fondateur de
Montpazier avait voulu qu'il y en eut au bout de chaque rue principale, sauf à
les tenir fermées pour la plupart dans les temps de danger. S'il en reste trois
aujourd'hui, ce n'est point parce qu'elles ont quatre mètres de largeur et
qu'elles ne gênent en rien la circulation, c'est qu'elles sont devenues des
propriétés particulières et que la commune n'est pas en mesure de payer le
droit de les démolir. Pour les rues couvertes qui entourent la place, même
inintelligence. Au xviiie siècle, on avait eu à rebâtir deux ou
trois maisons et on avait eu soin de conserver l'ancien plan en refaisant en
plein cintre les grandes arcades ogivales; on vient d'en rebâtir quelques
autres et on les a fait reculer de huit mètres. Ce qui était commode, il y a à
peine un siècle, serait-il devenu gênant? Craindrait-on de voir arriver des
voitures de cinq mètres de hauteur par cette route qu'on se propose de faire?
mon Dieu non. Les édiles de Montpazier ne soupçonnent pas que leur ville est un
monument, un beau, un curieux monument; mais, comme beaucoup de leurs
confrères, ils ont à un haut degré l'amour de ce qui est commun, l'horreur de
ce qui est original : voilà tout.
Encore
un mot sur Montpazier. On me pardonnera de rappeler que c'est dans cette petite
ville que Bernard de Palissy a été élevé. Il était né à deux lieues de là, dans
un pauvre village de la baronnie de Biron mais du diocèse d'Agen. Un arpenteur
de Montpazier le ramena d'une de ses excursions et se chargea généreusement de
son éducation. C'est à cet homme bienfaisant que nous devons un des plus grands
artistes de la renaissance.
BEAUMONT.
La très-petite ville de Beaumont, dont on a sous les yeux le plan
partiel, fut fondée, ainsi qu'on l'a dit précédemment, en 1272, douze ans avant
Montpazier. On voit d'un coup d'œil quelle extrême analogie les deux bastides
ont entre elles. Ainsi, quatre grandes rues, toujours de vingt-quatre pieds,
qui se croisent et qui deviennent des rues
couvertes le long de la place centrale ; des maisons entièrement
isolées, et cependant très-serrées les unes contre les autres ; une église
placée à l'angle nord-est de la place ; des ruelles analogues, au moins par
leur destination, aux lanes des
nouveaux quartiers de Londres : voilà des ressemblances essentielles. Examinons
seulement ; pour les expliquer, les différences. Beaumont est situé, comme
Montpazier, sur un plateau élevé d'où les eaux pluviales s'écoulent avec
facilité ; mais ce plateau est plus étroit. La place en conséquence n'a que
trente-quatre mètres de côté, et, par suite, l'espacement des rues étant moins
grand, les emplacements ont moins de profondeur. Au lieu d'être droit, le
plateau est coudé; les rues le sont aussi, cependant elles sont formées
d'alignements droits et se coupent à angles droits autant que possible.
Les rues couvertes ont à peu près six mètres de largeur, comme à
Montpazier; mais elles ne sont pas aussi bien ni aussi sagement construites.
Les pieds-droits des arcades sont carrés et n'ont que quatre-vingts centimètres
de côté, au lieu d'être en équerre. On ne voit pourtant pas, dans les maisons
anciennes qui subsistent encore, que la poussée des arcades ait nui à la
solidité des façades. Cela tient à ce qu'elle ne s'exerçait que très-près du
sol.
La ville n'a jamais eu deux enceintes, comme on pourrait le
croire au premier abord. La plus extérieure est seule ancienne et il n'en
subsiste qu'une faible portion ; soit qu'elle n'eût pas été terminée, soit
qu'elle eût été démolie, les habitants de Beaumont furent obligés, au xvie
siècle, de se créer d'autres fortifications, et ils y parvinrent tant bien que
mal en fermant l'ouverture de chaque rue et en murant les étroits intervalles
des maisons. Ces travaux, avec, la tour ronde qui occupe un des angles de la
nouvelle enceinte, remontent sans aucun doute aux guerres de religion.
L'église, un des meilleurs monuments ogivaux du Périgord,
offre aussi des fortifications. Une des tours du portail occidental est
couronnée de créneaux et de mâchicoulis. Celles que l'on trouve vers l'entrée
du chœur et qui présentent des chapelles à leur rez-de-chaussée, des logements
militaires à leurs étages supérieurs, avaient de même des mâchicoulis, mais
elles n'appartenaient pas tout à fait à la première construction. Enfin les
deux contreforts, qui terminent l'église à l'orient, contiennent de petits
réduits crénelés. Toutes les fenêtres sont d'ailleurs placées à une certaine
hauteur. Quant aux portes, elles sont défendues, l'une par les tours
occidentales, l'autre par un assommoir qui se trouve directement au-dessus.
Après avoir forcé les portes ou escaladé les fenêtres, les
assiégeants n'étaient point maîtres de l'église. On pouvait continuer à se
défendre sur les voûtes dont l'extrados, dallé et presque nivelé, était parfaitement
disposé pour cela ; les entraits de la charpente étaient plus élevés de un
mètre soixante-dix centimètres, de sorte qu'ils n'interrompaient point la
circulation. Cette église de Beaumont, qui possédait encore un puits et jusqu'à
des latrines, avait pris cette physionomie guerrière au moment même de sa
construction ou de son achèvement, dans la première moitié du xive
siècle, au plus tard. Mais pourquoi, dans ce cas, ces fortifications qui
contrastent avec l'apparence toute pacifique des maisons? c'est ce qu'il n'est
point difficile d'expliquer.
De 1243 à 1340,
on peut certainement dire que la France était en paix ; mais cette paix ne
ressemblait point à celle dont nous jouissons aujourd'hui et dont les
Gallo-Romains jouissaient au second siècle de l'ère chrétienne. Lorsque tant de
seigneurs, lorsque tant de villes avaient le droit de venger leurs injures par
les armes, la tranquillité n'était jamais complète, et, sans avoir les ravages
de la guerre, on en avait souvent les inquiétudes. Cela posé, il fallait bien,
même dans la paix, que chaque communauté eût un asile, un refuge; à défaut de
remparts, on fortifiait les églises.
Un curieux rapport, adressé à Alphonse de Poitiers par un de
ses sénéchaux, fera parfaitement comprendre quel était en ce temps-là l'état
social des provinces de la Guienne. M. de Gaujal; dans son excellente Histoire
du Rouergue, le donne en entier ; voici seulement le paragraphe qui est relatif
aux églises fortifiées et celui qui concerne la construction de Villefranche.
« Je, Gui, sire de Séverac, fais savoir à vous, sire, comte
de Poitou et de Toulouse, que Vivian, évêque de Rodez, grève de plusieurs
manières vos chevaliers et vos hommes de l'éveché de Rodez. Puis, sire, sachez
que comme vos gens construisent une ville nouvelle près de Najac, laquelle
porte le nom de Villefranche et que plusieurs personnes vont s'y établir et
bâtir des maisons, l'évêque a excommunié les habitants de cette nouvelle ville
et a maudit le lieu, ce qui a forcé beaucoup d'entre eux de se retirer et d'abandonner
leurs maisons déjà bâties; ce dont vous avez grand dommage... Ensuite, sire,
sachez que, quoique dans l'évêché de Rodez, il y ait plusieurs villes et
châteaux, la plupart des habitants n'ont d'autre fort que les églises ; et
qu'en temps de guerre les bonnes gens du pays mettent dans les dites églises,
leurs arches dans lesquelles ils serrent leur blé et leurs habits. Or,
sire, l'évêque a défendu de porter ces arches dans les églises et a excommunié
tous ceux qui les y placent. Les bonnes gens, qui n'ont que de très-petites
maisons, ne sachant où serrer leurs denrées, sont forcés de s'adresser à
l'évêque pour obtenir de lui la permission de les laisser dans les églises ; et
les excommuniés sont forcés de payer douze sous tournois pour leur absolution,
et il a levé beaucoup de douze sous[13] ».
On voit que l'âge d'or n'a jamais régné en France, pas même au xiiie
siècle, mais c'était bien pis en Italie, si l'on en croit Brunetto Latini[14].
« En
maison convient-ilh porveoir se li teins et li lius est en guerres ou en pais,
se cest dedans ville ou lonc de gens. Car les Ytaliens qui sovent guerroyent
entreaus se délitent en faire hautes tours et maisons de pierres. Et sé c'est
hors de ville, il font fosseis et palis et murs et tourneles et pons et portes
coléices, et sont garniz de mangoniaux et de saettes et de toutes choses qui
apartienent à guerre, por défendre et por getter, et por la vie des homes ens
et hors maintenir. Mais li Franchois font maisons grans et planiers et paintes
et chambres lées por avoir joie et délit sens noise et sens guerre. Et por ce
sevent mielz faire praelles et vergiers et pomiers entour leur habitacle, que
autre gent[15].
Car c'est chose qui valt moult à délit doner. »
Pour en revenir à Beaumont, je m'imagine que, lorsque
l'église fut fortifiée, le bourg n'avait pas encore de murailles. Cela est
d'autant plus probable que les fondateurs des bastides ne se chargeaient point
habituellement de les fortifier, mais laissaient aux habitants le soin de le
faire, lorsqu'ils étaient assez nombreux, au moyen d'un impôt ou d'un octroi.
En 1340, quand éclata la guerre avec les Anglais, une bastide bien plus
considérable, Villefranche de Rouergue, n'avait pas encore son enceinte .murale,
et cependant elle était plus ancienne de quinze ans que Beaumont.
MOLIÈRES.
Molières, à 3 lieues à l'est de Beaumont, n'est plus qu'un hameau de 250
habitants; mais au xive siècle, c'était une ville au moins aussi
considérable que Montpazier. Aujourd'hui son église, son château, sa place
publique et ses rues, qui s'étendent de tous côtés dans la campagne, en droite
ligne, attestent son ancienne importance. On ne sait à quelle époque là bastide
de Saint-Jean de Molières a été fondée, on ne sait pas davantage à. quelle
époque elle à été détruite. Mais, en 1292, on parle des coutumes de Saint-Jean
de Molières, et, en 1550, des consuls de Molières figurent aux états de
Périgord. Il ne reste plus sur la place qu'une seule maison à arcades, mais
elle montre que les rues couvertes dont elle faisait partie ressemblaient
exactement à celles de Beaumont. Du reste, même largeur de rues (24 pieds), et
même plan, sauf quelques modifications imposées par des mouvements de terrain.
L'église est à moitié détruite; quant au château, il est assez bien conservé
pour un château. Les Rôles gascons nous apprennent dans leur prodigieux latin,
qu'il avait été commencé par le sénéchal Guillaume de Toulouse, au commencement
du xive siècle. « Rex
constabulario suo Burdeg..... Suggessit nobis dilectus Valletus Ner Guill. de
Tholosa, senesc. Ner in Petrag. quod ipse quodam castrum apud Môlieras pro custodia prisohum et
defensione partium illarum incepit aedificare. » — 18 mai 1316.
LA LINDE.
La Linde, une des plus anciennes bastides d'origine
anglaise, est aujourd'hui un bourg de 1,500 âmes. On y retrouve le plan
ordinaire des bastides, mais il y reste fort peu de vieilles maisons. Les rues
sont sensiblement coudées vers la place centrale, parce qu'un des côtés de
l'enceinte longe exactement le cours de la Dordogne. Les trois autres côtés
avaient de profonds fossés, autant pour l'écoulement des eaux pluviales que
pour la défense de la ville.
SAINTE-FOI.
En entrant dans le département de la Gironde, la grande route
de Bergerac à Bordeaux traverse Sainte-Foi, qui faisait partie du Périgord
avant 1793. C'était une bastide anglaise dont j'ignore la date. C'est à présent
une jolie ville dont le nom témoigne encore qu'elle appartenait primitivement à
la fameuse abbaye de Conques. Il y a longtemps que je ne l'ai vue, mais un
extrait de l'histoire de Libourne suppléera au vague de mes souvenirs.
« Sainte-Foi », dit l'auteur de cet ouvrage, page26, « est une jolie petite
ville de 3,000 âmes, qui était anciennement assez bien fortifiée, dont la
plupart des rues paraissent avoir été tracées au cordeau et qui a une place
entourée d'arcades imaginées sans goût, puisqu'elles sont très-basses et que
les charrettes ou voitures sont obligées de passer dessous ».
Un des précurseurs de la nouvelle école archéologique,
feu M. Jouannet, fut frappé le premier de la physionomie originale de quelques
bastides du Périgord, et il s'est demandé le premier d’où venait leur plan si
régulier, si uniforme. Serait-il vrai, comme il l'a cru et comme on le croit
encore à Bordeaux, que ce plan vînt d'Angleterre? Serait-il vrai, même dans la
Guienne, que toute ville carrée, avec des rues qui se coupent à angles droits
et une place centrale entourée d'arcades, fût une ville anglaise? Je suis
fermement persuadé du contraire.
Sans rechercher si, au xiiie siècle,
l'architecture civile de l'Angleterre différait réellement de celle de la
France, je remarque d'abord que, sous Henri III et Edouard Ier,
l'autorité du roi d'Angleterre s'exerçait le plus souvent, dans la Guienne, par
l'intermédiaire d'hommes du pays. Ainsi, Jean de La Linde, qui fonda la ville
de ce nom, était du Périgord. Le sénéchal Jean de Grailly, qui dirigea la
construction de Montpazier, était de la même maison que le fameux captal de
Buch. Le maréchal Lucas de Terny et le sénéchal Guillaume de Toulouse, dont
l'un fonda Beaumont, dont l'autre acheva Molières, étaient de même des
chevaliers gascons ou français. Aucun Anglais n'est nommé à propos de ces
fondations du roi d'Angleterre; aucun Anglais probablement n'y a pris part.
D'ailleurs, nous l'avons vu, longtemps avant qu'Edouard d'Angleterre s'occupât
de fonder des bastides, un frère de saint Louis, Alphonse de Poitiers, en
remplissait le Rouergue et l'Agenais. Je n'ai fait le plan d'aucune de ces
bastides françaises, mais j'en ai vu plusieurs, et j'en connais d'autres par
des descriptions plus ou moins incomplètes. Or, elles sont en forme de carré
long; elles ont de larges rues qui se coupent à angles droits, et parfois une
place entourée d'arcades. J’ignore en un mot par quel caractère essentiel on
pourrait les distinguer des bastides anglaises. Il faudrait en conclure
que le type architectural des Villes
neuves, tout comme l'idée politique de leur fondation, a passé de
l'Agenais dans le Périgord et dans la Gascogne. Lorsque Castilhonnès fut fondé,
en 1259, dans une solitude que les deux évêques de Périgueux et d'Agen se
disputèrent ensuite, on voit que Gautier de Rampoux et Pons Maynard furent
expressément commis par le sénéchal d'Agenais pour tracer les bornes et sans
doute aussi le plan de la nouvelle ville. Cette circonstance jetterait
peut-être quelque jour sur la question qui nous occupe, surtout s'il était vrai
que Pons et Gautier eussent été ingénieurs à Montflanquin. Malheureusement cela
n'est pas bien sûr, quoique le savant qui l'a dit semble avoir eu à sa
disposition la charte de fondation[16] .
Il n'y aurait peut-être rien d'extraordinaire à ce que des plans tels que
ceux des bastides, aussi savants, aussi réguliers, fussent l'œuvre d'hommes
spéciaux, d'ingénieurs. Mais on sait d'autre part que ce Gautier était bailli
de Montflanquin [17], et cette qualité
exclurait apparemment celle d'ingénieur; tout au plus permettrait-elle de penser
que Gautier avait appris à faire des plans de ville lorsque sa résidence de
Montflanquin fut rebâtie sur un plan plus régulier, de 1240 à 1250[18] .
Baillis où sénéchaux, les officiers
qui fondaient une bastide pour le seigneur suzerain ne s'occupaient pas
seulement, j'en suis convaincu, de choisir un emplacement et de l'acheter : ils
calculaient les dimensions de la nouvelle ville d'après l'importance qu'elle
pouvait espérer d'acquérir ; ils s'occupaient de son plan, qu'ils tâchaient de
rendre plus commode et plus beau que ceux des anciennes bastides. Leur bastide
devait honorer leur administration ; elle était pour eux ce que son église
est pour un prêtre, ce que sa maison est pour un propriétaire.
Au surplus, ce n'est pas à un homme, ce n'est pas à une province,
ce n'est pas même à un pays
qu'il faut faire honneur de ces beaux plans de villes. Ils sont plus nombreux,
plus perfectionnés peut-être dans la Guienne que dans telle-autre partie de la
France; ils appartiennent plus particulièrement au grand siècle du moyen âge,
au xiiie siècle, mais ils doivent se retrouver partout où l'on a
fondé des villes neuves. Les bastides régulières qui fourmillent en
Guienne ne sont certainement pas rares ailleurs. Je crois même que tout ce qui
porte le nom de Villefranche ou de Villeneuve offre un plan régulier : la ville
neuve ou la ville basse de Carcassonne, entre autres. Je ne l'ai jamais vue,
mais voici ce qu'en dit un Guide du voyageur, en 1631[19] , et
cela suffit :
« Carcassona duplex... Ima urbs ad radicem prions, QUADRATURA AEQUILATERI EXSTRUCTA....Si œdificia quae lignea
et sine ornatu sunt, cum platearum symmetria paria facerent, elegantiorem
Gallia urbem non haberet : NAM VICI ET
PLATEAE ARTIFICIOSA DISPOSITIONE IN LONGUM PROTENSAE A TRANSVERSIS PLATEIS
RECTA LINEA DECUSSATIM TRANSSECANTUR. »
Or, on sait que là ville basse de Carcassonne, détruite par les Croisés,
fut rebâtie sous la direction des officiers de saint Louis, dans la deuxième
moitié du xiiie siècle.
Après tout, il est dans la nature des hommes d'aimer l'ordre
et la règle, et c'est pour cela que l'on s'est toujours fait la même idée de la
beauté et de la commodité des bourgs ou des villes. Jamais, qu'on le croie
bien, nos ancêtres n'ont-été assez absurdes pour rendre à plaisir tortueuses et
irrégulières les rues de leurs villes; ils n'avaient pas peur à ce point du
vent ou de l'ennemi, quoi qu'on en dise. Jamais, si ce n'est peut-être au xve
siècle, ils n'ont admis, ni dans leurs monuments ni dans aucune de leurs
œuvres, l'irrégularité sans motifs. Y a-t-il rien de plus symétrique que
les jardins du moyen âge devenus les jardins à la française? Veut-on comprendre
pourquoi la; plupart de nos vieilles villes sont si mal tracées? qu'on examine
comment les choses se passent de nos jours. A Paris, par exemple, de véritables
villes s'élèvent rapidement auprès de chaque barrière, aux Batignolles, à la
Chapelle, à la Villette, et bientôt sans doute elles ne feront plus qu'un avec
la grande cité. En moins de cinquante années, tout l'espace qui s'étend de la
Madeleine à l'enceinte continue sera couvert de maisons, ce sera un magnifique
quartier, soit, mais ceux qui le verront achevé n'auront-ils pas le droit de
s'étonner que les rues ne soient pas encore plus larges; qu'elles ne se
correspondent pas mieux, qu'on n'ait pas ménagé de vastes places, des squares
plantés d'arbres ; qu'on n'ait pas eu assez de prévoyance pour mieux régler,
pour mieux diriger ce grand courant de constructions? — Que sais-je? On dira
peut-être un jour, comme on le dit maintenant du moyen âge, que de notre temps
il n'y avait pas de voirie. Pour moi, je pense que jamais les
administrations municipales n'ont laissé aux citoyens la liberté d'empiéter à
leur gré sur la voie publique ; et je prouve par l'exemple des villes
neuves, où l'on a si bien tenu la main à la scrupuleuse exécution du plan
primitif; que toutes les villes du moyen âge avaient une voirie. J'ajoute
encore que les agents de ce service avaient les mêmes goûts, le même esprit que
nos voyers actuels, mais qu'ils étaient chargés de pourvoir à des besoins
différents et qu'ils luttaient contre des difficultés infiniment plus grandes.
— Ce qui appartient en propre au xviiie et au xixe
siècles, ce n'est point le désir de redresser et d'élargir les rues, comme le
témoignent toutes les villes bâties à neuf ou rebâties à la suite d'incendies
pendant le xiiie siècle, c'est l'invention des plans d'alignement,
et je confesse que je l'admire médiocrement. Quand un quartier est insalubre ou
impraticable, qu'on y ouvre une rue Rambuteau; quand une voie importante
est évidemment trop étroite, qu'on l'élargisse en abattant à la fois un rang
entier de maisons, rien de mieux : mais ne pourrait-on pas s'en tenir là? —
Lorsqu'une déclaration royale du 10 avril 1783 ordonna que le minimum de
largeur des rues de Paris serait porté à 30 pieds et qu'on ne pourrait rebâtir
ni réparer aucune maison, dans les rues qui; n'auraient que 24 pieds, sans se
conformer au nouvel alignement, on crut certainement avoir fait merveille.
Cependant on peut voir aujourd'hui que dix mètres ne suffisent pas plus que
huit, et que ce n'était pas la peine, pour un si mince résultat, de tourmenter
pendant quelques siècles les honnêtes bourgeois de Paris.
Nos plans d'alignement ont souvent le même défaut. Ils en ont un autre,
auquel je suis surtout sensible, c'est qu'ils condamnent à la destruction une
foule de monuments du moyen âge dont ils n'avaient tenu aucun compte. —- Ce
n'est vraiment pas sans inquiétude que je me permets de critiquer un système
accepté par tout le monde, et déjà en cours d'exécution. Il me semble cependant
qu'avec le reculement successif on a gâté jusqu'à présent cent rues pour une
seule qu'on a améliorée; alors n'est-il-pas singulier d'imposer aux citoyens
des sacrifices actuels, et de
grands sacrifices, dans l'espérance d'améliorations qui ne se réaliseront guère
avant deux ou trois cents ans?
Quant à l'habileté relative de nos
voyers, à Dieu ne plaise que je la méconnaisse, ni que je conteste jamais
aucune des vraies supériorités de notre époque ; j'affirme pourtant qu'ils
trouveraient quelque profit à étudier les œuvres de leurs devanciers.
—-Lorsqu'on voit naître une ville à côté d'une houillère ou d'une usine, on ne
s'inquiète guère aujourd'hui de lui tracer un plan régulier; mais enfin on
fonde quelquefois des villes, particulièrement en Afrique. Or, je ne sais trop
si ces créations modernes soutiendraient toujours la comparaison de celles que
nous venons d'admirer. — Les circonstances sont presque identiques. Il faut des
fortifications à l'abri d'un coup de main ; il faut donc aussi serrer les
maisons le plus possible, et ne pas perdre de terrain. Il faut, à meilleur
titre encore qu'en France, une place entourée de galeries. Il importe enfin de
répartir le plus également possible, dans toute la cité, le mouvement et la
vie. — Eh bien!, je gagerais que l'on a seulement deux rues principales au lieu
de quatre ; je gagerais que ces rues se croisent non pas aux angles mais au
milieu de la place (on n'y manque jamais), de manière à la rendre à peu près
inutile. Il faudrait aussi calculer d'avance l'avenir de la bastide qu'on
entreprend, de façon à ne pas mettre un bourg là où une ville est nécessaire,
et une ville là où l'on ne peut faire vivre qu'un bourg. Y réussit-on toujours
bien aujourd'hui? on y réussissait au moyen âge. — Jean de Grailly n'avait pas
la prétention de créer au milieu d'une forêt du Périgord une bien grande ville,
mais il savait que l'appât des privilèges ainsi que le besoin de sécurité
attireraient à Montpazier une population de deux ou trois mille âmes (les
circonstances ayant changé, cette population est retournée en partie aux
campagnes voisines); il fit donc préparer environ 300 emplacements de maisons,
dont 200 au moins ont été occupés. — A Beaumont, à La Linde, on avait adopté
des dimensions plus restreintes encore; mais à Villefranche sur l'Aveyron, à
Villeneuve dans la vallée du Lot, à Libourne au confluent de la Dordogne et de
l'Isle, on a voulu et on a créé des villes de 10,000 âmes. Libourne, c'est
Montpazier trois ou quatre fois plus grand. La place centrale a 5700 mètres
superficiels au lieu de moins de 2000 mètres, et la ville entière 318,000
mètres au lieu d'environ 100,000 mètres[20].
Une ville plus importante encore, qui passe à juste titre pour une des
plus jolies de la Guienne et de toute la France méridionale, Montauban, doit
probablement aussi la régularité de son plan à des ingénieurs du moyen âge.
Elle a été rebâtie en entier vers le règne de Louis XIII; mais les belles
rues couvertes qui entourent la place ressemblent toujours beaucoup à
celles de Montpazier. J'ignore la date précise de la fondation de Montauban;
j'ai cependant la certitude que c'est une bastide du xiiie ou du xiie
siècle. Je conclus : dans le langage usuel, ville gothique est synonyme
de ville mal tracée et parfaitement irrégulière; c'est une expression à rayer
de notre vocabulaire: Les villes gothiques par excellence, celles qui ont été
fondées au xiiie siècle, sont les plus régulières que nous ayons. Ce
sont véritablement, j'en demande bien pardon à M. Victor Hugo, des villes en
damier, et la plupart des villes en damier sont des villes du moyen
âge.
FELIX DE VERNEILH.
[La suite à l'un des prochains numéros.)