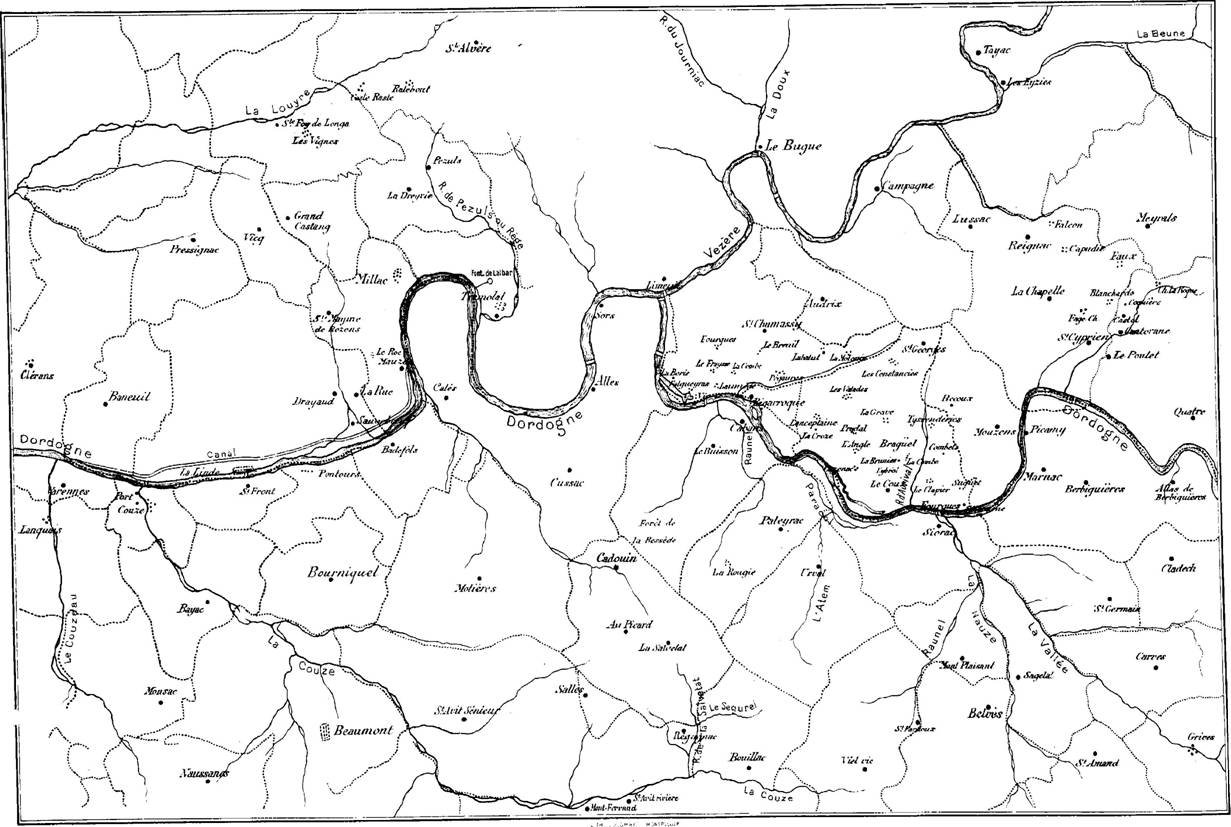Source :
Bulletin SHAP, tome XXXVII (1910)
pp. 357-401
POSSESSIONS
DES ARCHEVÊQUES DE BORDEAUX EN PÉRIGORD ET PRINCIPALEMENT DANS LE SARLADAIS[1] .
Les
archevêques de Bordeaux ont possédé des domaines importants dans le Sarladais.
On les a comptés parmi les seigneurs puissants de cette région, du XIVe
siècle jusqu'à la Révolution ; nous voudrions, administrativement et géographiquement
parlant, déterminer en quoi consistaient ces domaines.
Ces
renseignements nous sont fournis, sur ce point, par de nombreux documents
d'archives, provenant de l'archevêché de Bordeaux aujourd'hui déposés aux Archives
départementales de la Gironde, série G[2], et aussi par
le Cartulaire
Philiparie, récemment
entré à la Bibliothèque
nationale et
inscrit au calalogue, sous le n° 1922 des Nouvelles
acquisitions latines [3].
Si
trois notaires ont participé à la collation de ce manuscrit, le véritable et
seul auteur fut l'un d'eux Guillaume Philiparie.
« Moi, Guillaume de Philiparie, prêtre,
chapelain du Caillau[4] et
de Doissac du diocèse de Sarlat, notaire public, investi par les autorités
apostolique, royale et archiépiscopale de Bordeaux, commissaire juré de la Cour
d'officialité de Sarlat, originaire du bourg de St-Antoine del Fauro, au
diocèse de Limoges et habitant depuis plus de quarante ans le lieu de Belvès,
atteste et certifie avoir été attaché au service de l'église métropolitaine de
Bordeaux, dans ces temporalités, châtellenies et juridictions de Belvès, de
Couze, de Milhac, de Bigaroque et de Saint-Cyprien, de la sénéchaussée du
Périgord, et en plusieurs autres lieux... sous les épiscopats de Pierre
Borland, de Blaise de Grêle, d'Artus de Montauban et d'André Despinay... et
sous ces divers archevêques, remplissant tantôt le rôle de greffier, tantôt
celui de sénéchal, tantôt celui de juge, et cela pendant un si long temps que
je suis, grâce à la bonté de Dieu, parvenu à la vieillesse et suis dans
l'impossibilité de continuer mes services...[5].
Et
pour que l'on puisse tirer quelque profit de ce qu'il avait vu ou entendu, et
poussé à cela par le dit cardinal Despinay (cardinal au
titre de Saint-Martin in Montibus), et par les officiers, les vassaux et
feudataires du même seigneur, Philiparie s'est décidé, dans sa vieillesse, à
rédiger par écrit ce qu'il a vu, fait et rencontré.
En
conséquence, au nom de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saints
supérieurs, il a rédigé par écrit, ou fait rédiger par des scribes ou notaires,
ce qu'il a vu, fait ou rencontré dans les diverses temporalités, et ce terrier
ou mémorial, il en a commencé la rédaction en l'année 1496[6].
L'ordre suivi
pour chacun de ces terriers ou mémoriaux sera le même ;
en premier lieu, description de la juridiction et châtellenie; en second lieu,
énumération des églises et paroisses de chaque châtellenie ; en troisième lieu,
détermination des confrontations et limites de chaque juridiction et
châtellenie, transactions faites à leur occasion; en quatrième lieu, mises à
ferme annuelles, produits et redevances de chaque châtellenie ; en cinquième
lieu, droits annuels et fiefs que le seigneur a dans chacune des paroisses ; en
sixième lieu, hommages dûs pour chaque châtellenie, et en septième lieu,
énumération et rappel des procès et des usurpations relatifs à chaque
châtellenie.
Ce
programme, l'auteur le remplit exactement et, grâce aux renseignements qu'il
nous donne, on peut présenter l'histoire des châtellenies de Belvès, de Bigaroque,
de Couze et de Milhac, les seules dont il s'occupe.
A
une époque où nous n'avions pas pu nous procurer le manuscrit de Philiparie,
nous avons présenté l'histoire de la châtellenie de Belvès et, depuis, nous
avons complété, au moyen des documents fournis par notre cartulaire, les
lacunes de notre travail ; aussi, nous ne dirons rien de cette châtellenie de
Belvès (de
Bellovidere), la
plus importante des quatre, et sur laquelle notre auteur fournit des
renseignements très étendus. Nous nous bornerons, dans des notices successives
et sommaires, et en suivant de très près le manuscrit de Philiparie, à utiliser
les renseignements fournis sur les châtellenies de Bigaroque, de Couze et de
Milhac.
§ I. - Châtellenie de Bigaroque
La
châtellenie de Bigaroque, inférieure en valeur à celle de Belvés, est bien plus
importante que les châtellenies de Milhac et de Couze ; elle a joué aussi un
rôle historique plus intéressant que ces dernières, et, son histoire, si on
voulait la suivre dans les détails, viendrait se mêler aux histoires du
monastère de Cadouin et du prieuré de St-Cyprien, placés sur son territoire.
Notre travail est surtout géographique et administratif, aussi nous
occuperons-nous exclusivement de la châtellenie de Bigaroque. Nous n'aborderons
l'histoire de Cadouin et de St-Cyprien, qu'en vue des rapports que ces
établissements ont eus avec la châtellenie de Bigaroque.
(a) Description de la
châtellenie de Bigaroque
Dans
celle châtellenie, l'archevêque de Bordeaux, à titre de seigneur, a la
juridiction d'une manière complète[7] ; le castrum remarquable de
Bigaroque est situé tout près du fleuve de la Dordogne ; établi en un lieu
élevé, ce castrum
fut
une place de guerre très forte ; on y remarquait deux tours et de nombreuses
habitations, environ 160 feux[8], il y avait un
puits, une unique porte barbacane et dans une autre barbacane du castrum une simple
chapelle en l'honneur du bienheureux Blaise[9].
Le
castrum
de
Bigaroque est bâti sur le plateau et a sous sa dépendance l'abbaye de Cadouin,
le monastère de Saint-Cyprien, le lieu de Siorac, le castrum et lieu de
Campagne ; ces localités relèvent du seigneur archevêque de Bordeaux, à titre
de fief et comme dépendances du castrum de Bigaroque
(folio 108, verso).
Mais les
documents nous permettent de faire remarquer, dès maintenant, que ces fiefs ne
sont pas de même condition juridique. Si le monastère de Cadouin et le prieuré
de Saint-Cyprien sont des fiefs relevant de l'archevêque, comme seigneur de
Bigaroque, ils n'en sont pas moins compris dans le territoire de la châtellenie
de Bigaroque, dont ils font partie. Siorac, au contraire, forme une seigneurie,
vassale de Bigaroque, mais distincte de la châtellenie ; car sa paroisse ne figure
pas dans l’énumération des paroisses de la châtellenie, et on indiquera dans
les confrontations de celle-ci, qu'elle est hors la châtellenie de Bigaroque,
la Dordogne faisant division entr'elles[10]. Au contraire, Cadouin et Saint-Cyprien,
fiefs jouissant d'une certaine indépendance, font partie du territoire de la
châtellenie et figurent dans l'énumération des paroisses la composant.
La
même situation est faite à la paroisse de
Campagne mentionnée comme territoire de la châtellenie, mais ayant un seigneur
particulier ; Campagne relève de l'archevêque comme seigneur de Bigaroque. Nous
verrous dans la suite que les droits de l'archevêque, dans cette paroisse,
furent contestés et furent réduits d'une manière fort sensible.
S'il
fallait en croire Philiparie, le castrum de Bigaroque
aurait été acquis par voie d'achat du seigneur de Beynac, par le pape Clément
V, au profit et utilité de l'église métropolitaine de Bordeaux. Le même
archevêque ou sou neveu Arnaud auraient acheté, vers la même époque, la
châtellenie de Belvès, les châtellenies et juridictions de Couze de Milhac.
Cette
affirmation, en ce qui touche la châtellenie de Belvés, a été examinée par nous[11]. Sans revenir
sur cette question, pour laquelle les documents font défaut, constatons le
vague des affirmations de Philiparie ; au moment où il écrivait, les faits
antérieurs étaient mal connus, les titres avaient disparu ; dans tous les cas,
il paraît certain, d'après les documents, qu'une même condition fut faite aux
divers territoires qui allaient devenir et devaient rester si longtemps la
propriété des archevêques de Bordeaux.
Les Anglais y
avaient des droits puisque, en 1244, suivant un titre conservé aux Rôles Gascons, roi d'Angleterre
charge Amanieu de la Marche d'assurer la garde, avec Bernard de Beteille, des castra de Bigarok et de
Beauver[12] et qu'en 1305,
le roi d'Angleterre, Edouard 1er donnait mandat à son sénéchal de
Gascogne, Richard de Havering, et à ses fidèles Amanieu de Lebret et Me
Richard de Havering et Arnaud de Calva Penna d'étudier un projet d'échange avec
l'archevêque de Bordeaux des castra de Benner (Belvès de Bygarocke (Bigaroque), de Mylau (Milhac). de Cose (Couze), de Monterapto (Montravel et de la Mothe
de Saint-Paxence (la Mothe-Montravel), contre des
possessions seigneuriales de l'archevêque en Saintonge[13]. Cet échange
serait donc la base des acquisitions de l'archevêque de Bordeaux en Périgord,
ou, dans tous les cas, aurait servi de confirmation à des possessions plus
anciennes des archevêques[14] sur ces points.
Suivant notre cartulaire,
la châtellenie de Bigaroque aurait donc été acquise par voie d'achat du
seigneur de Beynac, et cela au profit de l'église métropolitaine de Bordeaux (ad utilitatem
ecclesie Burdegalensis) ; elle fut ainsi rattachée par les
archevêques à leur mense épiscopale[15].
Bigaroque
comprenait une villa sur laquelle le pape Clément V fit élever et construire
l'église paroissiale; elle fut placée sous l'invocation du bienheureux
Jean-Baptiste ; détachée de l'église du Coux dès sa fondation, elle fut unie à
perpétuité à l'église paroissiale du bienheureux Pierre de Cabans. A cette
église de Saint-Jean-Baptiste fut préposé un vicaire par l'église
métropolitaine de Bordeaux et le seigneur archevêque ne touche présentement ni
les dîmes réelles, ni les personnelles[16].
Le castrum de Bigaroque, en
l'année 1415[17], par l'action
concertée du seigneur de Limeuil, qui tenait pour les Anglais, et des habitants
de Sarlat, qui étaient sous l'obéissance du roi de France, fut pris et démoli,
et les papiers du seigneur archevêque de Bordeaux et ses autres biens y
existant furent enlevés, perdus et dispersés; et présentement dans ce castrum personne
n'habite, mais dans le village et depuis quelques années seulement, il y a 18 feux et très
pauvres[18].
Ce
seigneur avait au lieu de Bigaroque un four, auquel les habitants devaient
faire cuire leurs provisions de pain, moyennant la rémunération des fourniers
et le droit de tournage qui appartenaient au seigneur archevêque de Bordeaux[19].
Le seigneur
archevêque avait ses prés dans la plaine entre la Dordogne et le ruisseau de
Cabans. Ils étaient d'une contenance de quarante journaux de fauchaison. Le
seigneur de Cunhac en avait usurpé une portion ; les autres, au temps de Pierre
Berland, par les procureurs de cet archevêque, avaient été, pour la plus grande
part, arrentés aux gens du Buisson ; une seule pièce de pré restait à arrenter,
entre la Dordogne et le ruisseau de Cabans ; ce pré, jusqu'à l'arrivée du
seigneur capitaine de Bigaroque ou de tout autre officier résidant dans le castrum, comme
représentant de l'archevêque, fut arrenté à des habitants du Buisson, moyennant
une certaine redevance annuelle à payer à l'archevêque en proportion du temps
de leur jouissance[20].
De même et
anciennement le dit castrum avait une grande
vigne, au-dessus du castrum, du côté du
soleil levant ; et tous les hommes habitants de la dite châtellenie étaient
tenus, chaque année, les uns plus, les autres moins, à faire tous les travaux
nécessaires à la vigne[21], et les femmes,
qui n'étaient pas nobles, étaient tenues d'épamprer les vignes et de les
vendanger[22].
Les
hommes étaient tenus de faucher le pré du seigneur, les hommes et les femmes de
faire sécher le foin, et de le rentrer, à leurs frais, au castrum.
Quelques-uns
des habitants de la châtellenie étaient tenus, suivant une certaine proportion,
à fournir l'une et l'autre nourriture (pictantiam) nécessaire aux
faucheurs et aux travailleurs des vignes (folio 109, v°).
De même les
habitants de ladite châtellenie, pour leur part, chaque année, devaient fournir
au castrum
trois
grands couteaux nécessaires à couper le pain, dix tourtes de pain et certains
pains d'autres formes et la boisson en vin (vinatam).
Et de plus, à
certaines fêtes, les moutons nécessaires ; à certains jours, les oignons, et, à
certains autres jours, les fèves fraîches ; ils étaient ainsi un certain nombre
obligés à ces redevances et ils les payèrent pour la messe de l'archevêque de
Bordeaux, pendant de nombreuses années, après l'acquisition du castrum et de la
châtellenie, comme on le trouve rapporté dans les écrits et registres des
prédécesseurs dudit seigneur ; toutes ces redevances, ils cessèrent de les
payer par suite des guerres, car le castrum, une fois détruit
et démoli, personne ne resta plus dans la châtellenie, si ce n'est
quelques-uns, en petit nombre, au lieu de Saint-Cyprien et trois ou quatre feux
vers le château de Cunhac[23] ; et tout le
reste de la châtellenie fut inhabité pendant trente ans et plus (fol. 110, r°).
Le seigneur archevêque, comme ses
prédécesseurs, levait le commune (commun de la
paix), sur tous les habitants de la châtellenie, à l'exception des clercs, des
nobles et bourgeois qui en étaient dispensés.
Taux du commun :
Il
s'élevait pour chaque homme, à.................. 12
deniers ;
Pour
chaque paire de bœufs, à..................... 12 deniers ;
Pour chaque cheval ou
jument, ferré, en état de porter le bât, à 6
deniers;
Pour
chaque âne ou ânesse, à......................... 4
deniers ;
Pour chaque vache
portant le joug et ayant plus d'une année, à 6 deniers ;
Pour
chaque porc (à moins qu'il ne tette), à... 1
denier ;
Pour
quatre chèvres ou brebis, à................... 1 denier[24].
Dans
l'Histoire
de la châtellenie de Belvès [25], nous avons eu
l'occasion d'étudier l'origine et le fonctionnement du droit du commun de la
paix, nous n'y reviendrons pas, nous bornant à traduire, ce qu'en dit Philiparie,
à propos de la châtellenie de Bigaroque.
Le commun de la paix fut payé et levé, après le
repeuplement jusqu'à l'an du Seigneur 1470; mais alors comme les receveurs du
seigneur, et le seigneur Pierre Dubois (Petrum de Bosco) son vicaire et son receveur général exploitaient les
redevables; les habitants de la dite châtellenie en appelèrent au Parlement de
Bordeaux ; à partir de ce moment, ils ne payèrent plus, et par là, les recettes
du seigneur ont été diminuées de vingt livres et plus[26].
Rapprochons les
renseignements donnés aux pages 190 et 191 du cartulaire; il faut remarquer que
tous les fiefs de Bigaroque, après 1450, furent, pour le plus grand nombre,
arrentés à nouveau à des gens venant de divers côtés, et alors, suivant
l'ancienne coutume du pays, le commun était perçu,
comme il a été dit plus haut, et, à cause de cette charge, plusieurs des fiefs
du dit seigneur furent arrentés à un moindre prix, et maintenant les tenanciers
ne paient plus le commun; car les
officiers du Roi ne le permettent plus, au prétexte que le dit commun était payé en
remplacement des tailles royales, tailles qu'ils paient aujourd'hui. Mais cet
impôt avait été établi par les Rois au profit des seigneurs pour garder le
royaume de ses ennemis, et par la suppression de ce commun, le dit seigneur
se trouve fraudé et lésé, dans plusieurs de ses fiefs et dans ses droits
annuels[27].
De
même, le seigneur archevêque de Bordeaux a, dans toute la juridiction, sauf
dans le lieu et la juridiction de St-Cyprien, cotum et
gardacgium, droit
de cot et de garde.
Ces droits
étudiés à propos de la châtellenie de Belvés[28], consistaient :
le cotus,
en
la réglementation du droit de pacage et en la perception d'une redevance sur les
animaux ; le droit de garde est le droit de percevoir des amendes, en cas de
contravention, sur les gardiens de troupeaux, et aussi de mettre en fourrière
les animaux saisis en contravention de pacage [29].
Le
droit de cotus
ne
paraît pas avoir eu une grande importance, car il ne faisait pas l'objet d'une
mise à ferme spéciale, il était compris dans la ferme de la baylie de
Bigaroque, dont il formait une branche de revenus « qui cotus de
Bigarupe nunc comprehenditur sub assensa baylivie » (fol. 110,
verso) ; peut-être, peut-on induire de là, qu'à une époque antérieure et plus
prospère, le cotus
faisait
l'objet d'une mise à ferme particulière.
Ces
droits avaient été cédés à St-Cyprien aux habitants, en vue de l'entretien des
chemins et des murailles[30].
(b) Liste des paroisses dépendantes de la
châtellenie de Bigaroque.
Au folio 111,
r°, Philiparie nous donne la liste des églises paroissiales dépendantes de la
châtellenie de Bigaroque[31].
« 1°
Et,
en premier lieu, l'église et la chapelle du castrum de Bigaroque » ; par les
développements antérieurs, nous savons que l’église paroissiale de
Bigaroque avait été fondée par Clément V, sous le vocable du bienheureux
Jean-Baptiste et fut unie à l'église paroissiale du bienheureux Pierre de
Cabans ; la chapelle
du castrum est
la chapelle qui était dans une barbacane et dédiée au bienheureux Biaise.
2°
« L'église
de la Salvetat, près Cadouin », église fort ancienne dans la Bessède,
aujourd'hui ruinée ; elle est mentionnée en 1115, cartulaire de Cadouin.
3°
« L'église
de Cabans à laquelle est unie à l'église de Bigaroque ».
4° « L'église
du Coux (del Cos) » ; al cos, sous le vocable. St-Martin,
forme moderne Le Coux, réunie à Bigaroque, est une commune du canton de
St-Cyprien.
5°
« L'église
de Mozens »,
actuellement Mouzens, commune du canton de St-Cyprien ;
6°
« L'église
de St-Cyprien », sous
le patronage de Saint-Laurent et de Saint-Cyprien : c'était le siège d'un
prieuré conventuel de l'ordre de St-Augustin.
7°
« L'église
de Castels (Castillo ou Castello) » ; en 1309, le pape
Clément V[32] l'unit au
monastère de St-Cyprien ; l'église était sous le vocable de Saint-Clair[33].
Castel forme une commune du canton de
St-Cyprien.
8°
« L'église
de Reignac (de Renhaco) » ; forme Reyniacum (1333) ; église
détruite, le territoire fait partie de la commune de St-Cyprien.
9°
« L'église
de Lussac (de Lussaco) » ; c'est une ancienne paroisse, son
territoire fait partie de la commune de Campagne[34] .
10°
« L'église
de Campagne (de Campania) » ; Campagne forme une commune du canton
du Bugue ; c'était le siège d'un prieuré de l'ordre de St-Augustin, qui
dépendait de celui de St-Cyprien. L'église était dédiée à St-Jean-Baptiste et à
St-Blaise; d'après notre cartulaire, la paroisse dépendait de la châtellenie de
Bigaroque ; mais au XIVe siècle, elle avait rompu ces liens, elle
formait une paroisse hors châtellenie, et une justice spéciale indépendante[35].
11°
L'église
de Cathena »
ou de la Cadène St-Georges, au nord-ouest de la paroisse du Coux dont elle fait
partie ; c'était un prieuré conventuel de l'ordre de St-Augustin dépendant du
prieuré de St-Cyprien ; cette paroisse a été supprimée, et sou territoire forme
aujourd'hui l'extrémité nord-ouest de la paroisse du Coux.
Nous aurons à
revenir sur la constitution de la châtellenie de Bigaroque, en suivant la
délimitation qu'en donne Philiparie; pour le moment, et nous en tenant à la
simple énumération de ces paroisses, nous pouvons remarquer que ce territoire
forme un territoire allongé, allant de l'est à l'ouest; il est resserré vers
son centre et forme deux portions renflées; une, vers l'orient, est au nord de
la Dordogne, ce fleuve lui sert de limite au sud et la sépare de Berbiguières
et de Siorac; entre les paroisses du Coux et de Cabans, la châtellenie occupe,
pendant une petite longueur, les deux rives de la Dordogne, et forme un
renflement au sud du fleuve, au moyen des territoires qui entourent Cadouin.
Tenons-nous en à cette description
sommaire, les détails seront donnés par nous en suivant les délimitations de la
juridiction de Bigaroque, avec les juridictions voisines.
« Le seigneur archevêque, dans les paroisses
susdites, levait de toute ancienneté, et continua à lever dans la suite le commun dans
chacune des paroisses, et chaque année, suivant le taux fixe plus haut[36].
Et chacun des curés des dites paroisses était tenu,
chaque année, de payer au seigneur archevêque une livre de cire et deux sous ;
il devait les lever des habitants, les porter à l'archevêque
de Bordeaux et les lui payer; ordinairement, le recteur pouvait retenir pour
lui, pour peines et soins, une maison choisie par lui[37].
Le seigneur archevêque avait sur
toutes les paroisses de la châtellenie la juridiction haute, basse et
moyenne... ».
Sauf
les exceptions résultant des aliénations de tout ou portion de la justice,
comme nous le verrons bientôt pour le territoire de Cadouin et pour St-Cyprien
et son territoire.
En
dehors des paroisses de la châtellenie, le seigneur avait aussi les droits de
justice sur les dépendances de la châtellenie, c'est ainsi
« qu'au nord de Bigaroque, le
seigneur avait toute juridiction sur certains
territoires de la paroisse de Saint-Chamassy qui avaient été rattachés à la
juridiction de Bigaroque. ». Fol. 111, v°.
La paroisse de
Saint-Chamassy forme aujourd'hui une commune du canton de St-Cyprien ; au moyen
âge, elle faisait partie, au XIVe siècle, de la châtellenie de
Limeuil et de sa juridiction, en ce qui touche son chef-lieu et la partie nord
de la paroisse; mais la partie sud, longeant la paroisse de Bigaroque, faisait
partie de la juridiction de Bigaroque, et le rédacteur de notre cartulaire
attache une si grande importance à la délimitation de cette dépendance de
Bigaroque qu'il y revient par deux fois[38].
Nous établirons
bientôt, en étudiant les confrontations de la juridiction de Bigaroque, la part
que celle-ci avait dans la paroisse de St-Chamassy[39].
(c) Délimitation de la châtellenie de
Bigaroque.
Le cartulaire
Philiparie donne, à partir du folio 112, r°, jusqu'au folio 116, v°, les
confrontations de la juridiction de Bigaroque avec les juridictions voisines.
1°
Confrontations
avec la châtellenie de Belvès (de Bellovidere), les juridictions
de Bouillac et de Montferrant.
La
châtellenie de Bigaroque confrontait en plusieurs points à la châtellenie de
Belvès.
« La juridiction de Bigaroque confronte
avec la juridiction de la châtellenie de Belvès »[40], et ces
châtellenies sont divisées, au moyen des paroisses du Coux et de Cabans, du
côté de la juridiction de Bigaroque, et par les paroisses d'Urval et de
Palayrac, de la juridiction de Belvès. La juridiction de Belvès s'avance par la
paroisse d'Urval jusqu'à la paroisse du Coux et par la paroisse de Palayrac va
rejoindre la paroisse de Cabans ; un chemin fait là la séparation entre les
deux châtellenies et entre les paroisses en dépendant :
« jusqu'au chemin
ancien qui va de Cabans vers la Salvetat de Cadouin jusqu'au chemin
qui va du port de Sors vers Villefranche-du Périgord ;
La juridiction de
Bigaroque confronte avec le bois commun de Belvès (La Bessède), formant division entre les juridictions de Belvès et de Bigaroque,
et entre le bois lui-même des habitants de Boives et le bois des habitants du Buisson, relevant tous ces
bois et forêts du seigneur archevêque de Bordeaux [41] ».
La
juridiction de Bigaroque comprenait dans son territoire la paroisse de la
Salvetat de Cadouin; tous reviendrons sur ce point tout à l'heure « et cette
paroisse confronte du côté de Belvès avec
le bois commun de Belvès (la Bessède) et les dépendances du manse de Segurel ». Ce nom est
porté aujourd'hui par un ruisseau affluent de gauche du ruisseau de la Salvetat
affluent de la Couze, en amont de St-Avit-Rivière, « et avec la
paroisse et juridiction de Bouillac (de Bolhaco) appartenant au seigneur de
Cunhac et avec les dépendances du repaire de Régagnac (Reganhac) de la
juridiction de Montferrant, et avec la paroisse de Salles de Cadouin », c'est une
ancienne paroisse qui forme aujourd'hui une section de la commune de Cadouin, « et avec la
paroisse de St-Avit-Sénieur », (commune du canton de Beaumont) et en comprenant
dans la châtellenie et juridiction de Bigaroque, le bourg ancien dels Picars (au Picard, carte de
l'état-major), jusqu'à la descente vers Cadouin ».
2°
Confrontations de la châtellenie de Bigaroque avec la juridiction de Badefol (de Badaffollo, avec la paroisse
d'Alles.
Un chemin qui, partant de Cadouin et par la porte del Seyc va vers Limeuil, divise et sépare les paroisses de Cussac et de Cabans et partant les juridictions de
Cadouin nouvellement acquises, et de Bigaroque, et la juridiction de Badefol, ainsi la dite juridiction de Bigaroque confronte avec la juridiction de Badefol, au long et au moyen du chemin qui va de Cadouin à Limeuil, ce chemin entre les deux paroisses fait la séparation jusqu'à au-dessus et au droit de la Combe du Manse de FonBenryt.
La
juridiction de Bigaroque confronte : avec la paroisse de Alles ide Alanis)et en descendant par le fond de cette même combe eu comprenant, du côté de la paroisse de Cabans, le dit manse de Fon-Beunjt avec ses dépendances
jusqu'à une autre combe existant près la tour de Leyrac et avec les dépendances de Aleyrac et tendant droit et en descendant vers le fleuve de Dordogne; il faut remarquer que la juridiction de Bigaroque s'avance du côté de la paroisse d'Alles autant que la paroisse de Cabans s'avance du côté du castrum de Bigaroque [42] ».
Cette
observation est juste, car les limites extrêmes de là paroisse actuelle du
Buisson de Cabans, sur les rives droite et gauche de la Dordogne, sont en face
l'une de l'autre.
3°
Confrontations
de la châtellenie et juridiction de Bigaroque, pour la partie située sur la
rive droite de la Dordogne et au nord du fleuve avec les châtellenies et
juridictions voisines.
(a) Avec la
juridiction de Limeuil :
Nous avons constaté antérieurement que
la châtellenie de Bigaroque, en dehors des paroisses qui la constituaient,
exerçait sa juridiction sur la partie au sud de la paroisse de Saint-Chamassy ;
les confrontations entre notre châtellenie et celle de Limeuil, à laquelle se
rattachait la paroisse de Saint-Chamassy, sont bien indiquées dans notre
cartulaire; nous allons les reproduire et les déterminer en présence de l'état
actuel des communes de Saint-Chamassy et de Bigaroque.
Le seigneur archevêque
a la juridiction haute, basse et moyenne dans certains territoires manses de la
paroisse de St-Chamassy, dans laquelle paroisse sont de la juridiction de
Bigaroque : la rivière ou plaine de Bourlas et le territoire existant dans
cette plaine entre le ruisseau ou lac de Bourlas et le manse de Falgueyrac
(aujourd'hui Falgueyras suivant la carte d'état-major).
Et aussi se trouve dans
la juridiction de Bigaroque le territoire de Bartenos[43] (pour Bertenos) ; dans ce territoire se trouvaient
certaines terres arrentées par le seigneur Blaise de Grêle à Denys Bossel,
marchand de Limeuil, duquel arrentement il existe un titre grossoyé par maître
de Cuge, notaire à Limeuil[44] ; et se trouvent dans la même juridiction le dit
manse de Falgueyrac, le manse de Vic[45] les manses de la Melonie (la carte d'état-major a
par erreur la Melanie), les fourches patibulaires en pierre de Bigaroque, au
Boy de Rodas, le manse de la Combe, le manse du Breuil (de
Brolhio) le manse de Pechgaures
(aujourd'hui forme vicieuse, état-major Pégaures) avec ses dépendances ; le
territoire de Puech Breno ou Pech Breno[46] ; les manses de la Melonia et plusieurs autres
manses et territoires... ».
Remarquons
que, par cette mention finale, l'auteur du cartulaire nous prévient qu'il ne
nomme pas tous les manses et territoires, mais seulement et probablement les
plus importants. Mais, au temps où écrit l'auteur du cartulaire, le seigneur
était seigneur de toutes les dépendances de la seigneurie, ce qui importait
c'était de bien délimiter la juridiction en face de la paroisse de St-Chamassy
dont la portion nord relevait de Limeuil, et dont la partie au sud relevait de
Bigaroque et, un peu plus bas, l'auteur du cartulaire nous permet de bien
déterminer les limites entre les deux juridictions de Limeuil et de Bigaroque
dans la paroisse de Saint-Chamassy. Etablissons donc cette démarcation :
Et d'abord il faut remarquer qu'autant s'avance la
juridiction de Bigaroque du côté de la paroisse d'Alles, autant « avance la
paroisse de Cabans et du côté du castrum de Bigaroque au-delà de la Dordogne,
la dite juridiction de Bigaroque comprend dans ses confronts une portion de la
paroisse de St-Chamassy avec le lac de Bourlas, formant division entre les
juridictions de Limeuil et de Bigaroque, lequel lac est commun entr'elles ....
Ce lac ou
ruisseau de Bourlas, qui avait donné son nom à la plaine de Bourlas, où faut-il
le placer et existe-t-il encore ?
Falgueyrac,
dont la situation est connue, était de la juridiction de Bigaroque ; le lac ou
ruisseau de Bourlas faisait la division entre les juridictions de Limeuil et de
Bigaroque ; or, puisque, au sud de Falgueyrac, Vic et tout le pays est, sans
contestation possible, de la juridiction de Bigaroque, il faut en conclure que
le ruisseau ou lac de Bourlas, situé sur la rive droite de la Dordogne, se
trouvait au nord de Falgueyrac, et une pièce de 1771, publiée au Bulletin de la Société
historique et archéologique du Périgord[47], nous permet
d'affirmer que le lac de Bourlas n'était autre que le lac de Bonnelle dont il
est question dans cette pièce, qui n'existant plus à cette époque, n'existe pas
davantage aujourd'hui. Et puisqu'il faisait division entre les possessions de
Limeuil et de Bigaroque dans la paroisse de St-Chamassy les séparait l'une de
l'autre, il était au nord de celles de Bigaroque et au sud de celles de
Limeuil.
De là, au moyen
de bornes anciennes on montait par la plaine elle-même vers le soleil levant et
on englobait dans la juridiction de Bigaroque la Borie de Bertenos[48] jusqu'à des terres de tenanciers appelés Coderla et
de Ysavet, en comprenant une partie de ces mêmes terres jusqu'à un fossé ou
creux et en comprenant de même les prés appelés Beconcus existant dans la Combe
appelée del Fraysse et que détiennent Petrus Las Combas et certains autres
habitants de Limeuil.
Et de là en s'élevait
par la Combe même del Fraysse jusqu'aux dépendances des Manses de Furchis
(actuellement Fourques, carte d'état-major) qui sont de la juridiction de
Limeuil et aux dépendances des manses de la Olmeda.
Forme
moderne Laumède, forme vicieuse, car le nom provient ici de l'ormeau ou d'une
ormière, comme tout à l'heure du frêne; dans tous les cas, la simple vue sur
une carte de l'Etat-major permet de voir où passait la délimitation des
juridictions entre le village actuel des Fourques, où étaient probablement les
fourches patibulaires de St-Chamassy et le village de l'Olmède (l'Aumède).
Et en s'élevant par un
certain chemin ou carriera existant dans le manse de la Combe (actuellement Basse-Combe,
Etat-major) par lequel on va
desdits manses vers l'église de Saint-Chamassy...
L'ancien chemin est remplacé par une
route venant de St-Chamassy et débouchant sur Laumède.
En comprenant une
partie du manse de las Combas, dans la juridiction de Bigaroque jusqu'aux
divisions des biens et possessions du bourg de Saint-Chamassy, en comprenant
dans la juridiction de Bigaroque le manse de la Braude ou Brande[49] (porté à la carte de la Dordogne éditée par le
Conseil général) avec ses dépendances et aussi le manse del Bruelh aujourd'hui
Petit Breuil (état-major) avec ses dépendances, la division est marquée par un
chemin ancien existant près de Saint-Chamassy, traversant le chemin qui va de
Bigaroque et du Breuil à Saint-Chamassy et descendant à la fontaine Fon Luques
(la Combe de Fon Luques s'appelait aussi Combe de Roca autur, voir les
inféodations).
Et delà s'élevant
toujours entre le manse del Luc et de la Petita batut et comprenant dans la
juridiction de Bigaroque le manse appelé del Luc avec ses dépendances ;
Le village du
Luc encore existant nous permet de suivre la démarcation :
En comprenant et les
manses del Bruelh et les manses de la Petita Abatut et le manse de Pechgaures
(Pégaures forme moderne) et tout le territoire de Puech Breno jusqu'à une
certaine place et aux pierres plantées, en certains confins au-dessus dudit
ruisseau des territoires de Puech Breno, près du mance de la Granbatut (fol.
114, v°) et de là en descendant suivant les boules en pierre vers le soleil
levant jusqu'au chemin qui va de Bigaroque vers les manses de la Melonie et en
montant en suivant une combe existant entre le manse de la Melonie et le manse
susdit de la Granbatut, de la longueur de deux jets de fronde ou environ, et en
traversant le plateau vers le soleil levant, en suivant les bornes et les
pierres frontières, jusqu'au-dessus des manses de la Melonie et jusqu'à un
certain chemin par lequel on va du dit manse de la Melonie jusqu'au chemin
ferré allant de Limeuil vers Sarlat, et en suivant le chemin plus moderne qui
va jusqu'au chemin de Saint-Georges de la Cathène vers le lieu de Campagne (de
Campants)...
Dans
celle partie, la division nous paraît se confondre avec la délimitation de la
paroisse d'Audrix ; ainsi la juridiction de Bigaroque comprenait cette bande
territoriale au sud de la paroisse de St-Chamassy et tous les villages ou
manses importants qui y existaient à celle époque et dont la plupart des noms
se sont conservés jusqu'à la période moderne.
Nous
sommes arrivés en un point, au nord de St-Georges de la Cathène, sur le chemin
allant de ce lieu vers Campagne. Si les choses ne s'étaient pas modifiées, nous
devrions comprendre dans la juridiction de Bigaroque l'entière paroisse de
Campagne, puisque cette paroisse était comprise en entier dans la châtellenie ;
mais à Campagne était un seigneur, vassal de l'archevêque, qui avait cherché à
se rendre indépendant et y avait réussi en partie, d'où l'archevêque n'avait
plus que quelques vassaux dans la paroisse de Campagne, et Philiparie, qui nous fait connaître la démarcation de la juridiction de
Bigaroque, postérieurement à ces faits, doit en tenir compte. Voici la suite
des données de la délimitation de la châtellenie de Bigaroque:
Et de là en droite ligne, en
suivant les bois et les signes anciens des
juridictions de Bigaroque et de Campagne jusqu'à la séparation des paroisses de Lussac et
de Campagne, et de ce point en descendant les pentes d'une montagne, la la paroisse de Campagne jusqu'au chemin qui va de Campagne
vers le lieu de Las Eysias (les Eysies), et en comprenant
dans la châtellenie de Bigaroque le repaire de la Belsia, les manses de la Teulada, les manses de Nabinal et
le repaire du moulin et de l'étang de Folquier...
Le livre des transactions et procès nous apprend que du temps du seigneur
archevêque Blaise de Grêle, le manse ou repaire de Linars, situé dans la
paroisse de Campagne, de même que le repaire de la Belesia, situé dans la
paroisse de Campagne, les manses de la Teulade et de Nabinals avec leurs
dépendances (lesquels manses sont dans ladite paroisse de Campagne et dans la
juridiction de Bigaroque), étaient des fiefs de l'archevêque à cette époque ;
mais à partir de ce moment, un certain Me Ademarus Laboria, co-seigneur de
Campagne, troubla les vassaux de l'archevêque, au temps de Artus de Montauban
et, à la suite de certaines promesses faites par ledit Laborie au seigneur
archevêque de Bordeaux, le procès fut suspendu, qui était alors poursuivi
devant la Cour du seigneur sénéchal de Périgueux et Sarlat, par la volonté du
dit archevêque de Bordeaux, et ainsi furent dépossédés l'archevêque ses vassaux
; et les seigneurs de Campagne[50] prirent possession et de la seigneurie comme de la juridiction,
dans les manses et repaires de la Bolesia et de Linars[51].
... Avec une certaine dépendance même au delà du chemin
de las Eyzias et ainsi confronte la dite juridiction de Bigaroque avec la
juridiction de Tayac, puis en remontant le long du ruisseau descendant des
fontaines de Rinhac et de Falco (elle confronte là) avec la juridiction de la
Roque des Peagiers, en comprenant le fait et la paroisse de Lissac, les manses
del Puech et de la Roquette avec toutes leurs dépendances, en comprenant aussi
le lieu et castrum de
Rinhac, avec ses dépendances, les manses et territoires...
Il
résulte des mentions portées à notre cartulaire que la délimitation de la
juridiction et châtellenie de Bigaroque comprend une partie de la paroisse de
Campagne, et sur ce point, l'indétermination des localités laisse quelque
incertitude sur la véritable limite; mais celle-ci englobe certainement
l'entière paroisse de Lussac qui faisait partie de la châtellenie de Bigaroque.
Dans
tous les cas, il est des points de cette délimitation qui sont parfaitement
déterminés et serviront de point de repère, et, notamment, le fait que la
limite remontait le long du ruisseau descendant des fontaines de Rinhac et de
Falcon.
A
partir de là, voici les indications jusqu'à la Dordogne :
La châtellenie de Bigaroque confronte avec la
juridiction de la Roque des Peagers, en montant de la fontaine de Falcon par
un certain chemin qui va de celle fontaine vers le manse de la Capudie, en
comprenant le manse entier de la Capudie et en suivant et remontant ce même
chemin par le milieu du puy de las Ayas, en suivant le chemin jusqu'à la
rencontre du chemin par lequel on va de la chapelle vers la vallée moyenne,
dans lequel on entre et on s'avance par cet ancien chemin, en suivant le chemin
de Meyral jusqu'à la rencontre du chemin public allant de St-Cyprien vers
Tayac, en comprenant entre ce chemin le village de Tamsa Arayla avec ses
dépendances, en suivant ce chemin jusqu'au village du Cayrel et de là en
tournant entre le dit manse del Puech del Cayre et le manse del Fau, en
comprenant dans la juridiction de Bigaroque le dit village del Cayrel et le
village de la Paparotie avec ses dépendances.
La limite englobait ainsi tout le territoire que comprend
aujourd'hui, au nord-est, la paroisse de St-Cyprien, sans empiéter sur la
paroisse de Meyrals, ainsi les villages les plus rapprochés de la limite
étaient : Falcon, Capudie, Faux ; Paparotie ou forme moderne, Blancharde,
état-major.
La châtellenie de
Bigaroque confronte
avec
le chemin qui va de St-Cyprien vers Meyrals et le traversant (vers l'est) et de
ce chemin descendant à un certain ruisseau découlant des fontaines de Canta-Rana
et de la Gazalhana vers le Pontet, et suivant ce ruisseau lui-même jusqu'au
Pontet près St-Cyprien, et de là, tirant vers Beynac, en un certain lieu où
était plantée une borne en pierre, sur laquelle étaient portées les armes de
l'archevêque de Bordeaux, sur la face tournée vers St Cyprien et les armes du
seigneur de Beynac, sur la face tournée vers Beynac ; cette pierre, dit on,
faisait la division entre les juridictions de Bigaroque et de Beynac ; il y a
peu d'années de cela, cette pierre fut brisée.
La
limite arrivait ainsi à
un
fossé nommé de Catre (aujourd'hui Quatre, suivant la carte d'état-major), et de
là, vers le fleuve de la Dordogne (ici la frontière suivait la division
actuelle entre les paroisses de St-Cyprien et de Bezenac.
Si telle était anciennement la délimitation de la
châtellenie de Bigaroque, il ne faut pas oublier que les seigneurs de la Roque
et de Beynac avaient occupé un certain territoire comprenant terres et prés, à
partir d'une certaine borne haute dont la pierre était brisée, sur laquelle se
trouvaient les armes de l'archevêque et du seigneur de Beynac et, cela du côté de Beynac
jusqu'à la Dordogne et jusqu'au lieu et ruisseau del Pontet[52].
Et, par là, les juridiction et
châtellenie de Bigaroque confrontaient
avec la juridiction de Berbiguières relevant, à
titre de fief, de l'archevêque de Bordeaux, le fleuve de Dordogne formait dans
son cours lu division entre les deux juridictions[53], jusqu'à la paroisse et juridiction de Siorac,
relevant également de l'archevêque de Bordeaux; et (la juridiction de Bigaroque
confrontait ainsi) avec la juridiction de Siorac, le dit fleuve de Dordogne
formant division entre les deux.
Mais, (la juridiction
de Bigaroque) comprenait bientôt l'une et l'autre rive du fleuve, à partir d'une
boule ou borne se trouvant sur le bord du fleuve de Dordogne du côté de Siorac,
et de la dite borne ou boule la limite s'élevant au moyen de petites bornes,
fossés et termes jusqu'à la tête d'un certain abîme appelé de Paracol[54], lequel abîme est au-dessous de Castelréal et
confronte au tertre de Castelréal, lequel tertre est de la juridiction de
Belvès, et celle limite englobe dans la châtellenie de Bigaroque, entre les
dites confrontations et le ruisseau sortant de l'abîme de Paracol, la plaine
dite du Coux faisant partie de la paroisse du Coux[55].
Ainsi,
le cercle est fermé, et nous avons parcouru la délimitation entière de la
châtellenie de Bigaroque.
(d) Juridiction de
Bigaroque dans les territoires de Cadouin et de St-Cyprien.
Nous avons vu antérieurement que la châtellenie de
Bigaroque avait dans ses dépendances l'abbaye de Cadouin et le monastère de
St-Cyprien. Sans avoir la prétention d'écrire l'histoire de ces deux
établissements monastiques, établissons seulement tes relations qui existaient
entre eux et Bigaroque, au point de vue de la juridiction, et dégageons les
renseignements que contient, quant à eux, notre cartulaire de Philiparie.
1°
Cadouin.
Il faut
remarquer que le monastère de Cadouin très anciennement fut édifié dans la
forêt et le bois du castrum de Bigaroque, dans une vallée qu'on appelait Laval
Cadonha[56], entre
les localités de Bigaroque, de Molières et de Belvés, et, pour la majeure
partie sur la paroisse de Cabans et sur les confins des paroisses de Cabans, de
la Salvelat et de Cussac ; ainsi, quelques-uns des habitants sont paroissiens
de Cabans, pour la partie nord ; d'autres, vers le midi, sont paroissiens de la
Salvetat, et les autres hors la porte del Seyc jusqu'au ruisseau dit de
Cadouin, sont paroissiens de Cussac jusqu'au chemin qui va de Cadouin et de la
dite porte del Seyc vers Limeuil ; ce chemin fait division entre les paroisses
de Cussac et de Cabans et entre les juridictions de Cadouin nouvellement acquises et
de Bigaroque d'une part et la juridiction de Badefol, d’autre part »[57].
Cadouin étant situé dans la châtellenie de Bigaroque, il
devenait très difficile au seigneur archevêque de conserver sur cette partie du
territoire les droits de juridiction que comportait son litre de seigneur;
aussi les documents mentionnent-ils des abandons d'une portion de sa
juridiction au profit des abbés de Cadouin.
A une époque ancienne, d'après notre cartulaire,
le seigneur archevêque avait dans
la paroisse de la Salvetat de Cadouin la moitié de la juridiction haute et
basse avec l’imperium merum et mixtum et indivisément, avec noble
Pierre de Cunhac, seigneur du repaire de Cunhiac (comme tenant ses droits du
seigneur de Badefol) et, de même, le seigneur archevêque de Bordeaux avait la
moitié de la basse justice jusqu'à cinq sous et au-dessous et par indivis avec
le seigneur abbé de Cadouin ; cette moitié de juridiction basse, comme l'a
entendu raconter Philiparie, le dit Cunhac l'acquit par échange du seigneur
abbé et des religieux de Cadouin ; et, en conséquence, présentement (1496)
toute Juridiction haute, basse et moyenne avec l’imperium
merum et mixtum de la paroisse de La Salvetat, appartient en commun et par indivis au dit
seigneur archevêque de Bordeaux et au seigneur de Cunhac, mais, en respectant
la juridiction récemment cédée aux moines de Cadouin du haut des collines en
descendant vers Cadouin »[58].
Qu'était cette juridiction nouvelle cédée aux moines de
Cadouin? Notre cartulaire nous en détermine le caractère et l'étendue
territoriale, en nous rapportant le titre transactionnel intervenu sur ce point
entre le seigneur archevêque et l'abbé de Cadouin.
Cette transaction fut faite le 8 août 1471
entre Philiparie, fondé de procuration de l'archevêque de Bordeaux,
Artus de Montauban, agissant comme seigneur de Bigaroque et le seigneur Pierre
de Ganh, par la grâce de Dieu abbé de Cadouin, et les religieux de l'abbaye de
Cadouin, de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Sarlat.
Voici
les clauses et les accords intervenus :
1° La
juridiction haute, basse et moyenne dans le territoire de Cadouin, dépendant
tant de la paroisse de Cabans que de la paroisse de la Salvetat, à partir du
haut des collines par où les eaux descendent vers Cadouin[59], appartiendra à l'abbé et aux religieux de Cadouin ;
2° Cette
juridiction, le seigneur abbé et les religieux de Cadouin doivent reconnaître
la tenir, à titre
de fief, du
seigneur archevêque de Bordeaux, en qualité de seigneur temporel de Bigaroque,
sous obligation d'hommage et de serment de fidélité, et avec accapte de
soixante sous de monnaie courante, à chaque changement de seigneur archevêque, et à chaque changement d'abbé, et à charge d'une rente de
huit livres de monnaie courante avec autant d'accapte et, cela, avec toute la
fondalité ;
3° Les dits abbé et
religieux de Cadouin, en vue d'assurer l'exécution de leurs engagements,
assignèrent et affectèrent, en conséquence, au profit du seigneur archevêque de
Bordeaux, certains fiefs qu'ils avaient, soit dans la juridiction de Bigaroque,
soit dans la juridiction de Belvés ;
4° Les
huit livres de rente et autres droits le seigneur archevêque les lient d'une
façon complète, excepté : 1° en ce qui louche les droits de paccage, à l'occasion desquels un procès est engagé ; 2° à propos du bien détenu par les habitants du Buisson
et relevant de l'archevêque de Bordeaux, et 3° à la limite de la juridiction de Cadouin entre le bois
commun de Belvés et le chemin ancien qui va de la croix de la Palme vers
Cadouin du côté de la Salvetat[60].
Ainsi,
à une époque où le fief s'était transformé, le seigneur ne conservait, grâce à
lui, que des redevances pécuniaires, comme représentation de son domaine
supérieur ; les droits de juridiction, conséquence du fief, prenaient une grande
importance par les droits pécuniaires nombreux, dont ils devenaient l'occasion,
et, en abandonnant à ses vassaux, une portion de ses droits de juridiction, le
seigneur leur abandonnait une partie importante de sa seigneurie. Dans la
pratique, les concessions de cette nature donnaient presque toujours lieu à des difficultés ; le vassal
voulant en étendre la portée, le seigneur voulant, tout au moins, en maintenir
la teneur, et même quelquefois en atténuer les conséquences, l'histoire de nos
châtellenies nous fournit de ces faits de nombreux exemples.
2° Saint-Cyprien.
Et il faut noter que le lieu de Saint-Cyprien est
une dépendance du castrum de Bigaroque, et le prieur et certains nobles plus bas
nommés possèdent la basse justice limitée ; elle s'étend et s'exerce aux lieux
et paroisses de St-Cyprien, de Capella (La Chapelle près St-Cyprien) de Rinhac; et, dans ces dits lieux et paroisses, le
prieur et les nobles de Saint-Cyprien sont en possession de l'exercice d'une
nasse justice limitée ; ils possèdent le droit de tenir des mesures
particulières pour le blé et le vin ; celles-ci diffèrent des mesures de
Bigaroque ; il en est de même de la paroisse de Mouzens[61].
Saint-Cyprien,
aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Sarlat, fut un prieuré
conventuel de l'ordre de Saint-Augustin ; son église avait pour patrons
Saint-Laurent et Saint-Cyprien. Autour du prieuré se forma une agglomération
importante close de murs[62].
St-Cyprien
était une dépendance de la châtellenie de Bigaroque et l'archevêque de
Bordeaux, comme seigneur de Bigaroque, y exerçait les droits de juridiction ;
mais la basse-justice, limitée d'une façon rigoureuse, appartenait au prieur et
à certains nobles de Saint-Cyprien ou des environs.
Les
conflits de juridiction furent fréquents entre le seigneur archevêque et les
prieur et nobles du lieu ; ils furent apaisés pour un temps, sauf à recommencer bientôt par
des transactions successives.
La
première en date et la plus importante remonte au commencement du XIVe
siècle ; notre cartulaire la mentionne et en résume les dispositions au fol.
117, v° et suivants ; elle fut constatée dans un acte dressé par Me Bernard Caprarii
(sic),
notaire
impérial, et avait été approuvée par le souverain pontife Clément V (fol. 118, r°).
Le
texte complet se retrouve dans les Regesta Clémentis V papae, année 4e,
n° 3984 (cap. 324, fol. 63 a); d'après cette source, nous ferons connaître la
transaction intervenue entre le cardinal archevêque et le prieur de
Saint-Cyprien.
Un
débat des difficultés s'étaient élevés[63] entre Bertrand,
archevêque de Bordeaux, et Hugo (de Beynac), prieur de Saint-Cyprien, son
vassal, dont voici l'objet : l'archevêque prétendait être investi de la juridiction
haute et basse et de l’imperium mixtum et merum, dans les
localités de Capella (la Chapelle) et de Rinhaco (Rignac), près
Saint-Cyprien, et dans leurs dépendances ; au nom de son église métropolitaine
de Bordeaux, il affirmait être en possession ou quasi-possession de l'exercice
de toute juridiction et cela depuis un temps ancien (et se esse in
possessione vel quasi ibidem exercendi omnimodam jurisdictionem et ab antiquo
fuisse.)
Il
prétendait aussi, au nom de son église métropolitaine, à la
juridiction haute à l’imperium merum du lieu et
paroisse de St-Cyprien; qu'en conséquence de ses droits, on devait porter
l'appel à sa Cour de Bigaroque, de tout jugement susceptible d'appel rendu au
nom des prieur, chevaliers et nobles de Saint-Cyprien.
Et
enfin que le prieur devait reconnaître tenir à titre de fiefs dudit archevêque
les localités de Capella
et
de Rinhaco
et
toutes ses possessions dans les paroisses de Mouzens et du Coux.
Et
le prieur, de son côté, affirmait être investi de la juridiction haute et basse
dans les paroisses de Capella et de Rinhaco et dans le
monastère, le cloître, le marché de Saint-Cyprien et dans les fours et moulins
que le prieur avait présentement à Saint-Cyprien.
Et
pour faire cesser sur ces points toutes difficultés, une transaction amiable
fut arrêtée, entre les parties, dont voici les principales clauses :
1°
La juridiction haute en son entier et l’imperium merum et mixtum des localités de
Capella
et
de Rinhaco
et
de leurs dépendances appartiendront, en leur entier et à perpétuité, à
l'archevêque et à ses successeurs.
2°
De même que la haute juridiction, l’imperium merum et mixtum du lieu et
paroisse de Saint-Cyprien, appartiendra, à perpétuité, à l'archevêque et à ses
successeurs « quia
inventum est quod fuit ab antiquo sic », car il a été constaté qu'il en a été
ainsi, anciennement.
3°
Mais la basse justice, dont l'émolument, au dire du prieur, s'élève à sept sous
et au-dessous, pour les localités de Capella et Rinhac, appartiendra
audit prieur.
De même, la
basse justice, jusqu'à la même somme, du lieu de St-Cyprien et de la paroisse,
appartiendra en commun au prieur et aux chevaliers et seigneurs du dit lieu ;
et, comme il a été d'usage jusqu'ici, les droits de ban et de règlements, en ce
qui touche la basse justice, seront faits au nom du prieur, des chevaliers et
des nobles.
4° De même, la
haute justice seulement jusqu'à soixante sous, pour faits qui se produiraient
dans le cloître et dans le monastère de St-Cyprien et dans la clôture du
cloître, comme il en est d'usage, et quels que soient les délinquants,
appartient au prieur.
De même, la
juridiction pour faits dont la réparation ou la peine ne s'élève qu'à soixante
sous, par la coutume et le droit, si ces faits sont à la charge de gens
relevant du prieur, (familia ipsius prioris) et non d'autres
personnes, et ont été commis dans les fours et moulins que le prieur possède
présentement à St-Cyprien, la juridiction en appartiendra au prieur à l'avenir.
Mais,
au cas où les délits et crimes commis ou qui viendraient à être commis à
l'avenir dans le cloître, monastère et clôture déterminée plus haut, et dans
les fours et moulins, donnaient lieu d'appliquer la mort, la mutilation, le
bannissement ou la rélégation ou toute autre peine supérieure à soixante sous,
suivant la coutume et le droit. La poursuite, la condamnation et l'exécution
appartiendraient au seigneur archevêque, même pour les délinquants faisant
partie de la familia
prioris.
5°
Le dit prieur et ses successeurs s'engagent et promettent l'exécution de bonne
foi, que toutes les fois qu'il y aura lieu d'appeler d'une décision judiciaire
rendue par le prieur, les chevaliers et nobles ou par leurs juges, l'appel sera
porté à l'audience de la Cour de Bigaroque du seigneur archevêque.
6° Le dit prieur
tient et reconnaît tenir à fief du seigneur archevêque, tous les droits qu'il a
dans les paroisses de Mouzens et del Cos (du Coux, et, de même, pour les
localités de Capella et de Rinhac et de leurs dépendances, salvo jure
quolibet
alieno.
7° L'archevêque,
en acceptant cet arrangement ou transaction, se défendait de porter aucun
préjudice à la situation juridique des chevaliers et nobles de St-Cyprien, dans
leurs relations avec le prieur, situation sur laquelle l'archevêque et le
prieur avaient des vues différentes, et par cet arrangement transactionnel le
dit seigneur archevêque entendait expressément ne porter aucune atteinte aux
droits des chevaliers et nobles et viguiers de St-Cyprien, ni vouloir les
mettre hors de sa seigneurie, ni donner au dit prieur par cela aucun droit
nouveau[64].
Cette
transaction fut approuvée par les membres du prieuré de St-Cyprien, comme par
l'église métropolitaine de Bordeaux ; elle fut dressée à Bigaroque dans le
palais de l'archevêque, l'an du seigneur MCCCIIII indictione II, Sede romana
vacante, le
8 du mois d'août, c'est-à-dire le samedi avant la fête du bienheureux Laurent
martyr, en présence de grands personnages représentant l'archevêque et le
prieur, de nombreux seigneurs de la région, et retenue par Bernardus Caprarii[65], prêtre du
diocèse de Bordeaux et notarius seu tabellio
publicus auctoritate imperiali.
Elle
fut confirmée par le pape Clément V, à Villandrault, diocèse de Bordeaux le 12
des kalendes de décembre l'année 4e de son pontificat, soit le 21
novembre 1308.
Ainsi,
ce document nous montre le seigneur archevêque de Bordeaux, en tant que
seigneur de Bigaroque, investi de la haute justice sur St-Cyprien et son
territoire, et ayant consenti à l'abandon de la basse justice, limitée
généralement à 7 sous, au profit des prieur et de certains nobles de la
localité ou des environs.
Ceux-ci,
nobles et prieur, exerçaient cette basse justice en paréage; ils avaient donné
à la localité une administration municipale rudimentaire ; mais la communauté voulut
former un corps municipal et s'organiser en consulat. Or, ces modifications
intéressaient l'archevêque de Bordeaux, le chapitre de St-Cyprien et les
seigneurs investis de la basse justice; de là, des contestations, à cette
occasion, entre ces autorités rivales[66].
L'étude
de ce point intéressant pour l'histoire de St-Cyprien sort un peu de notre
sujet et nous entraînerait trop loin.
Le
débat élevé en 1304, entre Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, seigneur
de Bigaroque, et Hugues de Beynac, prieur, et terminé par la transaction
ci-dessus analysée, se reproduisit à d'autres époques, et se termina entre
lesdits archevêques et prieur par des transactions nouvelles ; les unes, comme
celle qui intervint, en 1533[67], entre l'archevêque
et François de la Cassanhe, prieur de Saint-Cyprien, et Jean de Fages, seigneur
dudit lieu, co-seigneur avec le prieur de la basse justice, ne firent que
rappeler les dispositions de la transaction de 1308, et d'autres y apportèrent
sur des points peu importants, quelques modifications.
Cette
situation ne paraît avoir subi de modifications jusqu' à la Révolution.
Cependant, de
documents conservés aux Archives de la Gironde, on peut affirmer que, tout au
moins, au commencement du XVIIe siècle, l'archevêque chercha à
aliéner les droits de suzeraineté qu'il avait, à St-Cyprien, probablement pour
se mettre en mesure de payer les sommes que l'Etat avait mis à sa charge, sur
son temporel : cette aliénation fut consentie par M. le cardinal de Sourdis, archevêque
de Bordeaux, le 27 juin 1613, au profit de messire Jean-Jacques de Montesquiou
de Sainte-Colombe[68].
Bien que cette
aliénation eût été exécutée, M. Henry d'Escoubleau de Sourdis, frère du dit
cardinal, et son successeur à l'archevêché, obtint le 19 novembre 1741, un
arrêt du Grand Conseil qui le rétablit dans la propriété de cette terre et
juridiction, à la charge de rembourser à l'acquéreur, M. de Montesquiou, la
somme de neuf mille livres.
Et, comme ni le
seigneur archevêque de Sourdis, ni M. de Béthune, son successeur, ne furent en
situation d'opérer ce remboursement, M. de
Montesquiou garda la jouissance de la terre, qu'il détenait encore en 1660.
Et,
le 19 mai 1660, les habitants de la dite terre et seigneurie de St-Cyprien
offrirent à de Béthune d'exercer le rachat pour réunir inséparablement la dite
terre au domaine de l'archevêque ; et, celui-ci promit de rembourser à la
communauté la somme de 4.900 livres, somme jugée suffisante pour opérer le
rachat, et, pour assurer l'exécution de son obligation, M. de Béthune engagea
les droits utiles et profitables de la seigneurie jusqu'au remboursement
effectif.
La communauté
jouit des droits engagés; elle aliéna tous les offices de judicature,
aliénations qui lui permirent de rentrer dans une très grande partie de la
somme prêtée.
L'archevêque
sentait la nécessité de faire cesser cet état de choses, et de rembourser les
4.900 livres à lui prêtées ; dans ces conditions, Joseph Prunis, prêtre,
docteur en théologie, prieur royal du prieuré de St-Cyprien, tant en son nom
qu'au nom de son chapitre, promit de fournir la somme de 4.900 livres pour en
faire l'offre et exhibition à la communauté de St-Cyprien en la personne de son
syndic.
Et, en
considération de ce que cette opération était à l'avantage de son siège,
l’archevêque de Bordeaux Champion de Cicé, seigneur haut justicier da
St-Cyprien, etc., affecta et hypothéqua tous ses biens à la sûreté du dit prêt,
consentant que le dit sieur prieur et son chapitre prissent et perçussent
annuellement sur les fermiers ou régisseurs de la terre de Bigaroque la somme
de 240 livres, pour leur tenir lieu d'intérêt du dit capital jusqu'au
remboursement du capital, non exigible par le prieur et chapitre, mais dont
l'archevêque pouvait opérer le remboursement à sa volonté[69].
Cet
acte démontre qu'à la veille de la Révolution, l'archevêque de Bordeaux était
encore en possession de ses droits sur St-Cyprien, dans les conditions des
transactions antérieures.
La seule chose
importante à constater est la seigneurie et supériorité de l'archevêque de
Bordeaux, en qualité de seigneur de Bigaroque sur le prieuré de St-Cyprien et
son territoire ; ce qui entraînait pour le prieur l'obligation de faire hommage
et serment de fidélité. Notre cartulaire contient, sur ce point, des renseignements
intéressants, et on nous excusera, à cause de leur pittoresque, de les
rapporter.
Au
temps de l'acquisition de Bigaroque, faite du seigneur de Baynaco (Beynac), le
pape Clément V transporta l’hommage que faisait jusque là le prieur de
Saint-Cyprien à l'évêque de Périgueux, à l'archevêque de Bordeaux, Arnaud,
seigneur de Bigaroque. Le seigneur de Bigaroque était le seigneur supérieur des
fiefs du seigneur prieur, et celui-ci tenait encore à fief une partie de la
basse justice en commun avec les chevaliers et nobles de St-Cyprien. Le premier
hommage ou reconnaissance fut fait par Hugo, prieur de St-Cyprien en 1307 ;
les chevaliers et nobles de St-Cyprien font hommage lige et prêtent serment de
fidélité au seigneur archevêque pour la partie de la basse justice de
St-Cyprien qu'ils tiennent par indivis avec le prieur de St Cyprien[70].
Le prieur de
St-Cyprien tenait à fief de l’archevêque de Bordeaux, en tant que seigneur de
Bigaroque, son suzerain, toute la temporalité qu'il avait dans les localités et
paroisses de Saint-Cyprien, de Chapelle, de Rinhac, de Mouzens et ailleurs,
dans les domaines de l'archevêque de Bordeaux.
En
signe d'hommage et de la donation faite, le seigneur archevêque recevait, en
entrant au prieuré, la clé de la tour la plus haute de la fortification du
prieuré, que le prieur avait déposée, sur l'autel le plus élevé de l'église de
St-Cyprien[71].
L'archevêque
la livrait à ses gens; ceux-ci ouvraient la porte de la grande tour et
montaient au haut de la tour, d'où ils criaient par trois fois Bordeux, Bordeux
et
par trois fois Bigarupe,
Bigarupe. Et
les autres serviteurs de l'archevêque pouvaient escalader les murailles formant
fortification dudit prieuré et crier de la même manière et, à sa sortie du
prieuré, le seigneur archevêque devait restituer et confier la clé au prieur[72].
(e) Revenus et impôts : leur mise à ferme.
Suivant
un usage ancien, la perception directe des revenus et des impôts n'était guère
pratiquée, le seigneur affermait le droit de les percevoir, moyennant un prix, soit
débattu de gré à gré, soit déterminé à suite d'adjudication[73].
Ces
adjudications étaient généralement faites à Bigaroque vers la fête de la
Nativité de Saint-Jean-Baptiste.
Le seigneur se
faisait représenter dans la châtellenie par un bayle auquel était confié,
moyennant un prix de ferme, le droit de percevoir les droits de justice, les
amendes jusqu'à 60 sous, le droit de cotus, les droits
perçus à l'occasion des actions en justice et des défauts ; la baylie était
affermée, en une seule fois, pour Bigaroque et pour St-Cyprien ; en général, le
prix de ferme s'élevait à quarante livres de monnaie courante, quelquefois
plus, quelquefois moins.
En conséquence
de cette ferme, le bayle devait supporter les dépenses des officiers du
seigneur, dans les cours de justice, dans les assises et en vue du commun [74], payer un
receveur ou greffier ou expéditionnaire et le jour des assises le dîner des
jurés suivant l'usage ancien.
Le greffe des
juridictions du seigneur était affermé, en général, pour 16 livres, quelquefois
plus, quelquefois moins.
Le port de
Bigaroque avec les péages de terre et d'eau, pour toute la juridiction, était
affermé pour 200 livres de monnaie courante, quelquefois plus, quelquefois
moins[75].
Les
péages et leudes étaient perçus suivant le tarif inséré au chapitre des
hommages[76] .
La moitié du
port de Siorac, relevant du seigneur archevêque était affermé 10 livres,
quelquefois plus, quelquefois moins.
Les
poissons des pêcheries et le droit de pêche était affermé pour 5 livres,
quelquefois plus, quelquefois moins[77] .
Les
épaves de la juridiction étaient affermées généralement trente sous,
quelquefois plus, quelquefois moins; et ce prix de ferme diminue chaque année,
à la suite de la dépopulation du pays.
On
affermait le produit des blasphèmes contre le nom de Dieu; l'amende se divisait
en trois parts; probablement, comme à Belvès, une des parts appartenait au
seigneur, une autre à l'église paroissiale où avait eu lieu le blasphème et la
troisième part au dénonciateur[78], la part du
seigneur s'élevait à 20 sous en général.
Un
des impôts les plus importants de l'époque consistait en la dime qu'on
percevait dans les paroisses ; notre cartulaire contient sur cette perception
des renseignements intéressants.
Sans
avoir à aborder l'histoire des dîmes, nous savons qu'à l'époque de notre
cartulaire elles étaient admises dans toutes les paroisses et qu'elles
présentaient la plus grande variété, soit pour l'étendue des produits frappés,
soit pour leur fonctionnement ; la coutume, à défaut de titre,
servait à
fixer
le fonctionnement.
En outre, à
cette époque, elles étaient souvent inféodées, soit en totalité, soit en
partie; des titres ou l'usage servent de base pour déterminer l'étendue de
l'inféodation.
Notre cartulaire
contient sur cette matière des renseignements intéressants pour les paroisses
du Coux et de Mouzens.
(a) Paroisse du Coux.
Celle
paroisse était l'une des plus importantes de la châtellenie, une des plus
fertiles.
La
dîme[79] portait sur une
foule de produits du sol et se divisait en gran et petit devers pour les
habitants astreints, ce qui correspondait à une division des dîmes en grosses
et petites dîmes.
La dîme des blés
et légumes de la paroisse du Coux était affermée par la Cour du seigneur, au
plus offrant et à l'extinction des feux.
Le
curé du Coux avait droit à la moitié du prix de ferme.
Le
décimateur adjudicataire opérait les perceptions qui s'élevaient, en général, à deux
cents charges de blé, soit froment, seigle, baillargue et avoine.
Mais
le recteur du Coux n'était pas obligé de se contenter de la moitié du prix de
ferme, et il était le maître de renoncer à sa pari du prix de ferme et de
réclamer sa moitié et en nature, auquel cas il en assurait à ses frais la
perception sur les redevables. Il y avait une dîme du vin, du lin, du chanvre,
des chevreaux et agneaux vivants, et de la laine et de quelques autres
produits, ce qui constituait le petit dever ; cette dime
était, en général, affermée à prix d'argent pour 60 livres de monnaie courante,
quelquefois plus, quelquefois moins.
Le
recteur avait la moitié de cette dime, laquelle moitié, la ferme consentie, il
peut réclamer en nature et lever pour lui.
(b) Paroisse de Mouzens.
Dans la paroisse
de Mouzens, la dîme ne paraît porter que sur les blés; et, de cette dime, le
prieur de St-Cyprien en prenait la moitié, le recteur de Mouzens, un quart, et
le seigneur archevêque avait l'autre quart.
En général, elle
rapportait cent charges de blé, quelquefois plus, quelquefois moins. .
La
ferme faite, le prix s'en partageait, suivant les proportions ci-dessus, entre
les ayants droit ; et le décimateur, auprès des habitants, assurait la
perception en nature des dîmes, à ses périls et risques. Mais le prieur de
St-Cyprien, comme le recteur de Mouzens, peuvent réclamer et recevoir leur part
en nature s'ils le veulent, et le décimateur fermier sera libéré, vis-à-vis
d'eux, de la part du prix de ferme leur revenant et ils assureront pour leurs
parts la perception en nature.
Nous
ne savons rien pour les dîmes des autres paroisses de la châtellenie, dans
lesquelles la perception directe ou la mise à ferme pouvaient être pratiquées à
la volonté des intéressés[80].
Grâce à un
document inséré aux Reqesta de Clément V,
nous pouvons donner pour Mayral (Meyrals forme moderne) des renseignements sur
la dime perçue dans cette paroisse.
A
la demande de Raymond, évêque de Périgueux, et pour augmenter les ressources
très faibles du monastère de St-Cyprien, le pape approuva l'union de cette
paroisse avec le monastère de St-Cyprien, sur laquelle celui-ci avait le droit
de patronage.
Cette
union était faite sous la condition que le monastère entretiendrait à Meyrals
un vicaire perpétuel compétent, avec droit de présentation on cas de vacance.
Le vicaire aura
et gardera les vignes, prés, jardins et maisons dont avait la jouissance, au
moment de l'union, l'église de Meyrals; en outre, le prieur de St-Cyprien, ses
successeurs ou le collecteur des dîmes de la dite paroisse, doivent au vicaire
toute la dime de la laine, du lin, du chanvre et du carnelage de la paroisse et
de l'église ; la moitié de la dîme du vin et un setier de froment et quatre
setiers de méteil, et cela chaque année ; le vicaire jouira, en outre, des
offrandes et autres émoluments sous quelque nom qu'ils se présentent,-et il
supportera toutes les charges d'entretien de l'église, et le monastère de
St-Cyprien aura pour lui toute la dîme du blé de la paroisse, à l'exception des
setiers réservés au vicaire (un de blé et quatre de méteil).
Enfin
une autre ressource appartenait au seigneur.
Le castrum formait une enceinte
fortifiée, protection puissante pour le pays, les habitants devaient, avec le
seigneur, en assurer la défense ; ils étaient tenus-à en assurer la garde et
d'y faire le guet.
« Le roi de
France, Charles VII, par une ordonnance royale vers l'année 1450, année de la
pacification de son royaume, décida entre autres choses, qu'en cas de guerre,
tous les sujets dépendant des châtellenies feraient les guets et gardes au castrum
; mais, qu'en temps de
paix, ils n'y seraient plus tenus, les seigneurs du castrum
avec leurs serviteurs
en assureraient la garde, et les sujets paieraient au seigneur, à titre de droit
de garde, par an 5 sous tournois.
Et les habitants de
Bigaroque et les sujets obligés à assurer la garde, payèrent, en remplacement deux
sous et demi au temps du seigneur Blaise de Grêle, archevêque, et, aujourd'hui,
ils ne paient plus rien de ce chef [81] ».
(f) Hommages, procès et occupations
Notre cartulaire
contient, sur les hommages ou concessions à cens pour chacune des paroisses de
la châtellenie, des renseignements très nombreux ; comme aussi il relève avec
soin les procès qu'avait à soutenir le seigneur archevêque pour la défense de
ses droits, et les occupations à son préjudice du fait des seigneurs voisins et
qui avaient entraîné des diminutions de sa seigneurie.
Nous
n'avons pas l'intention d'étudier, d'une manière complète, cette partie de
notre sujet; nous l'avons fait pour la châtellenie de Belvès, chap. I, IV et V,
pages 33 à 55 du tirage à part. Nous n'avons, après un nouvel examen du sujet,
rien à modifier à nos conclusions.
Cependant,
en laissant bien des renseignements de côté, il nous est impossible de ne pas
indiquer les renseignements que fournit sur ces points divers notre cartulaire.
(g) Hommages
ou concessions à cens.
Nous
trouvons dans notre cartulaire plusieurs listes des vassaux et des hommages
faits, en 1337, pour les paroisses de Cabans, Bigaroque, Le Coux, Lussac (fol. 179
à 182, ; en 1459 (fol. 182 et suiv.) ; les hommages furent reçus, à
Saint-Cyprien, le 10 février 1489 (fol. 160 et suiv. ) pour les paroisses de
St-Cyprien et de Mouzens; pour les paroisses du Coux et Bigaroque, les hommages
furent reçus à Belvés le 20 septembre 1493 (fol. 146 et suiv.) et le 12
septembre 1493, au même lieu, par Jean Joly, prêtre, pour les mêmes paroisses.
Ces actes d'hommages ne décrivent dans leurs déclarations que l'objet même
donné en inféodation, avec les tenants et aboutissants ; mais, grâce à ces
indications très succinctes, nous obtenons cependant des renseignements sur la
topographie, les fontaines, ruisseaux, chemins et autres particularités du
pays. .
Ainsi, nous
constatons l'existence d'une pêcherie aux Hégor, paroisse de Cabans, (fol.
128); d'une autre à Vic (fol. 130). Dans la paroisse de Cabans, nous constatons
l'existence d'un ruisseau appelé Rivus de Roanel ou Raunel, d'un canal del
Viguier, et d'un autre ruisseau appelé de Carbonieyras, paroisse de Cabans ;
dans la paroisse du Coux, la Combe d'Aurival[82], formée par le
ruisseau d'Aurival, descendant-des plateaux de St-Georges la Catène, coulant du
nord au sud, et se jetant dans la Dordogne ; il est parallèle à la limite de la
paroisse de Mouzens.
J'emprunte à notre cartulaire deux
hommages qui y sont relatés, pour que l'on puisse se rendre compte des
renseignements qu'ils peuvent fournir.
Déclaration de
Guillaume de Puymouste, habitant
du lieu de Saint-Cyprien qui tient à St-Cyprien du seigneur archevêque de Bordeaux …..
quoddam hospicium vocatum de Lossa, situm in loco Sancti Cipriani, infra murum
noviter constructum, confrontans
cum fossato dicti locicum hospicio nobilis Bertrandi de Virazel, vanella media,
et cum hospicio Ademari La Myanna et cum portali de Lossa et cum carriera
publica qua itur de dicto portali versus monasterium Sancti Cipriani (fol.
160).
Déclaration de Pierre de Vars et ses frères... partem territorii vocati La
Besseda, siti in parochiis de Paleyraco et de Cabans, confrontans cum itinere
antiquo quo itur de loco ubi erat posita Crux de La Palme versus Cadunum et cum nemore de Bellovidere
et cum pertinenciis de la Rocgia (La Rougie, état-major, commune de Paleyrac)
et cum quadam cruce vocata La Crosilha, et cum juridictione domini abbatis
Caduni quam idem dominus sibi transportavit (fol. 128).
Toutes
les déclarations mentionnent les charges en argent, en céréales ou en corvées
dues par les tenanciers; elles n'étaient pas très élevées, quelquefois elles
présentaient une certaine indétermination ; c'est ainsi que pour des cessions
de terres et de prés, nous trouvons cette clause, après avoir indiqué que la
redevance serait de dix deniers tournois, et autant d'acapte,
« Cum pacto
augmentandi predictum redditum et accaptamentum ad ordinationem duorum proborum
virorum, si predictum pratum non sit bene arrenduatum cum predictis decem
denariis T. de redditu et accaptamento ».
Cette clause est
exceptionnelle, nous ne l'avons rencontrée que deux fois (fol. 137) et il est
remarquable que les tenanciers trouvaient là une garantie contre l'arbitraire
seigneurial, dans l'intervention de deux prud'hommes pour la justification de
l'augmentation eu égard aux produits du pré.
On peut induire
de l'ensemble de notre cartulaire : 1° que
la dépopulation, conséquence des ravages de la guerre de Cent Ans, était
réparée; que les tenanciers accouraient de toutes parts pour obtenir des
concessions de l'archevêque ; 2° que le pays présentait à peu près la même
situation, que nous lui voyons aujourd'hui ; on peut suivre très facilement (ce
travail, je l'ai fait complètement pour la paroisse du Coux) et identifier les
manses, villages et propriétés, mentionnés dans notre cartulaire avec les
indications de la carte d'état-major, et, à l'exception de quelques localités
dont le nom se modifiait à cette époque ou s'est modifié dans la période
moderne, on peut affirmer que la condition de nos paroisses fut à l'époque de
notre cartulaire ce qu'elle est encore aujourd'hui[83].
Il semblerait, si l'on en croyait certains
passages du cartulaire de Philiparie, que les archevêques furent peu soucieux
de leurs intérêts matériels et que, par négligence de leurs officiers ou
représentants, leurs droits furent compromis ; des faits de ce genre ont pu se
produire à certaines époques ; mais il ressort des documents, provenant des
archives de l'archevêché, qu'à toutes les époques, les archevêques et leurs
agents apportèrent tous leurs soins à assurer la conservation de leurs droits,
fiefs, cens et rentes leur appartenant ; on en sera convaincu, si l'on parcourt
les renseignements cités en note pour la châtellenie de Bigaroque et les
paroisses la constituant[84].
(A suivre) A. Vigié.
pp. 444-456.
POSSESSIONS
DES ARCHEVEQUES DE BORDEAUX EN PERIGORD
ET PRINCIPALEMENT DANS LE SARLADAIS (Suite et fin).
§ 2. - Castrum et Châtellenie de Couze.
Suit le mémorial
et livre terrier du château et juridiction de Couze du diocèse de Sarlat[85].
« Et tout d'abord, il
faut rappeler que le castrum de Couze fut très fort, situé eu un lieu élevé ;
dans lequel château se trouvaient une tour haute et forte, beaucoup de demeures
nobles et autres habitations. Tout près de la tour se trouvait une convenable
chapelle, et, entre la tour et les autres habitations, un puits très profond et
une place. Dans sa plus grande partie, le château était entouré de fossés et du
côté du bourg de Couze étaient beaucoup de belles habitations à l'entrée du castrum
[86].
Ce château fut détruit
et démoli au temps de Charles VII, roi de France, pendant la guerre entre ce roi
et Henri, roi d'Angleterre, vers l'année du Seigneur 1448, par noble Jean de La
Crose, seigneur de Lenquays (alors avec beaucoup d'autres seigneurs voisins
dans le parti des Anglais), avec ses compagnons, et, cela grâce à la mauvaise
garde du château.
Et la grande tour et
toutes les antres habitations du dit castrum furent détruites, la chapelle démolie, et les gens
du seigneur archevêque de Bordeaux en furent chassés; les archives du seigneur
archevêque furent prises, détruites et dispersées, et tous les biens dudit
château, meubles et immeubles, furent aliénés et le château lui-même fut occupé
par les plus proches voisins, au point que personne ne reconnut plus tenir
aucun bien du dit archevêque, et cela jusqu'en l'année 1454.
Alors, noble Bozon La Brande,
majordome et attaché au seigneur Pierre Berland, archevêque de Bordeaux, de
bonne mémoire, avec l'aide de l'autorité royale, prit possession du château
démoli et des autres châteaux du seigneur archevêque de Bordeaux, existants
dans la sénéchaussée de Périgueux ; et, à ce moment, personne n'habitait dans
le castrum, ni
dans la châtellenie de Couze[87] .
Dans la châtellenie de Couze, il n'y a que trois
églises :
D'abord, la chapelle du
château de Couze, l'église paroissiale administrée par un prieur de l'ordre de
St-Benoit, qui en est vicaire perpétuel, et l'église de Bayac.
La châtellenie de Couze
confronte du côté de Badefol, à une borne en pierre se trouvant près du chemin
qui va de Belvès vers Couze, du côté du nord au-delà d'une certaine combe, se trouvant
entre la dite borne et la colline ou puy le plus élevé de Couze et descendant
au-delà de la même combe de vers Badefol, au moyen de boules et signes anciens,
droit au fleuve de Dordogne et comprenant une pêcherie ancienne appelée lo
Pesqueyro sur le fleuve lui-même dépendant très anciennement du castrum
de Couze ; la limite
descend le long de la Dordogne et sur l'autre rive et comprend le fleuve en
entier avec toutes les pêcheries, le port de Couze et jusqu'au port de Lenaco,
port qui appartient au seigneur de Lenquays[88] .
Et, du dit port,
s'élevant vers le midi et comprenant dans la juridiction de Couze le manse de
Levalop avec toutes ses dépendances, en suivant les bornes terminales entre les
juridictions de Couze et de Lencays, d'après les marques faites aux arbres, par
l'ordre du seigneur Pierre Du Boys, vicaire de l'archevêque de Bordeaux Artus de Montauban, de
bonne mémoire, jusqu'au sommet de la montagne du Couze de vers Lencays et jusqu'au chemin qui va de Couze vers Monsac.
Et la juridiction de
Couze comprend seulement la paroisse de Bayac, laquelle paroisse
confronte avec la paroisse de Monsac (à
l’ouest et au sud) avec la paroisse de Burniquel (à l'est) et
avec la pnroisoe de Couze (au nord):
Les
paroisses de Couze et de Bayac étaient tenues à fief de l'archevêque de
Bordeaux ; le seigneur le plus anciennement mentionné est Bertrand des Marques,
seigneur de Couze ; son tombeau fut trouvé dans une chapelle dite de Bayac en
l'église de Couze ; sa fille Raymonde avait épousé un Serval et avait apporté
la seigneurie de Couze dans cette famille ; la famille de Serval, famille riche
et puissante du pays, dont nous trouvons les membres à Belvés, à Monpazier, à
Siorac, garda longtemps la seigneurie de Couze dans ses possessions ; son
église porte un cerf à la clef de voûte, rappelant la possession de cette
famille. Dans tous les cas, un acte d'hommage de Belvès, en 1459, est fait à
l'archevêque par noble Margarita de Servallo, fille légitime et héritière
universelle de noble Bernard de Serval, fils lui-même de Jean de Serval
(Johannes de Servallo de Coza)[89] ; Marguerite de Serval avait épousé un
Bosredon, ses enfants Pierre de Bosredon et Arnaldus de Bosredon sont
mentionnés dans notre cartulaire.
Voici
les faits que relate notre cartulaire :
Du
temps du seigneur Artus de Montauban, archevêque de Bordeaux, une transaction
fut faite par l'intervention de Philiparie, qui en retint l'instrument, entre
l'archevêque, d'une part, et Marguerite de Serval et ses enfants, d'autre part.
Comme les dits
de Bosredon (Pierre et Arnaud) avaient prêté la main à la séparation de la
paroisse de Bayac de la juridiction de Couze, ils s'engagèrent et promirent de
la recouvrer et de la rattacher à nouveau, mais ils n’en firent rien; c'était là la principale cause de la
transaction; d'un autre côté, les consuls de Beaumont s'étaient emparé et
détenaient encore la justice jusqu'aux lieu et église de Couze.
En outre, comme
l'archevêque avait concédé la basse justice aux Bosredon, jusqu'au chemin qui
allait de Monsac vers Couze, et du côté de Belvès jusqu'au chemin de Belvès
vers Couze, ces chemins laissaient du côté de Couze une certaine colline, un
bois et quelque territoire ; mais Arnaud de Bosredon déplaça le chemin, prit
possession du Puy et du territoire, éleva des difficultés et fit des procès et
ne tint aucune de ses promesses.
Ainsi
les droits de l'archevêque furent diminués, ils le furent encore par d'autres
occupations ; ainsi, le seigneur de Badefol et les habitants de La Linde
occupèrent le territoire entre la première boule en pierre et le sommet de la
colline de Couze jusqu'au fleuve de la Dordogne; en outre, le seigneur de
Badefol occupa sur le fleuve lo peschayro ; laquelle pêcherie a une grande valeur et
valait beaucoup anciennement pour le castrum de Couze, comme
Philiparie l'a entendu dire par d'anciens témoins. Ainsi les fiefs de
l'archevêque diminuaient tous les jours, et notre cartulaire constate que le
seul hommage subsistant est celui d'Arnaud de Bosredon, qui doit hommage pour
ce qu'il détient au lieu et paroisse de Couze, et pour la basse juridiction de
la paroisse de Bayac et pour les autres biens qu'il détient dans cette paroisse[90] .
Parmi
les anciens vassaux du seigneur, il y en avait trois qui portaient le nom de
Coza ; à tous, succéda Fina de Coza qui abandonna le lieu de Couze pour se
transporter à Bigaroque, où elle mourut, laissant pour son héritier universel
l'archevêque de Bordeaux.
Les
revenus de l'archevêque dans, la juridiction de Couze se trouvaient très
diminués au moment de la rédaction de notre cartulaire; le port de Couze
n'était plus affermé; il avait été abandonné, à titre de ferme perpétuelle, par
l'archevêque Blaise de Grêle à Jacques La Borie de la Linde ; on avait compris
dans la concession le moulin situé au Port.
Le
péage et la baillie étaient affermés chaque année pour une somme de soixante
sous tournois, quelquefois moins, à charge de supporter les frais des officiers
du seigneur et pour les audiences.
Cette
ferme comprenait les blasphèmes.
De même le greffe
était affermé jusqu'à 10 sous, quelquefois pour moindre somme.
Tels sont les
renseignements de notre cartulaire sur cette possession peu importante de
l'archevêque de Bordeaux[91] .
§ 3. - CHATELLENIE ET JURIDICTION DE MlLHAC.
« Suit le mémorial
ou terrier du castrum, lieu
et juridiction de Milhac[92], du diocèse et de la sénéchaussée du Périgord (fol.
214 v° à 217).
Le château de Milhac
est situé sur un rocher de forme arrondie ; là, étaient une grande tour, palais
et habitations, une convenable chapelle et un puits d'eau abondante et très
agréable à boire, et, près du castrum se trouvait une source d'eau vive.
Ce château, la
juridiction en dépendant, et la châtellenie dont il était le chef-lieu,
appartenaient à l'église métropolitaine de Bordeaux ; l'acquisition en avait
été faite au profit de celle-ci par le pape Clément V ; ce château fut pris,
détruit de fond en comble vers l'année du Seigneur 1412, par les seigneurs de
Limeuil, de Sainte Alvère, de Longa et autres nobles, voisins du dit castrum
; et, par cet
événement, les documents relatifs au castrum, et les biens, meubles, en furent tirés et aliénés,
et le castrum fut
dévasté suivant les récits anciens.
Le castrum
avait, dans ses
dépendances et très près de lui, une grande garenne clôturée, où se trouvaient
des prairies et des bois ; dans cette garenne se rencontraient anciennement des
animaux sauvages, et, avant l'acquisition faite par le pape Clément V, on avait
l'habitude de les y chasser. Deux nobles personnages portaient le surnom de
Milhaco, c'est à eux que le dit pape avait acheté la juridiction ; ils y
vécurent et leurs héritiers continuèrent à porter le nom de Milhac, et ils
perçurent dans la juridiction de Milhac quelques cens; pendant de nombreuses
années, après l'aliénation de la juridiction ; à tous leurs droits succéda le
seigneur archevêque de Bordeaux.
Dans la dite
juridiction sont comprises en entier, trois églises paroissiales, savoir :
1° L'église et paroisse
de Mausac ; (Mauzac Et. maj. réuni à Sainte
Mayme de Rosens (canton de Lalinde)
;
2° L'église de
Drayau, jusqu'au ruisseau de Drayau, dans son entier ;
3° L'église et
paroisse Sancti Maximi de Rousaco en son entier (St-Mayme de Rosens, forme
moderne, commune du canton de Lalinde).
Et cinq
paroisses, en partie seulement, savoir :
l° La paroisse de
Tremolato in parte; (Trémolac, commune du canton de Sainte
Alvère) ;
2° Parochia de Pesul in
parte; (Pezul, commune
du canton de Sainte-Alvère) ;
3° Parochia de
Sancta-Alvera in parte, (Sainte-Alvère, canton, arrondissement de Bergerac)
;
4° Parochia Grande
Castanee in parte ; (Grand Castang, commune du canton de Sainte
Alvère) ;
5° Et
parochia de Vico in parte (Vicq, Vic, commune du canton de Lalinde).
Et la juridiction de
cette châtellenie s'étend jusque et le long du fleuve de Dordogne en s'élevant
vers Trémolac jusqu'au droit d'une fontaine appelée Lalbar ; cette fontaine est
dans te coteau tout près de Trémolac et de là en s'élevant par un chemin ancien
jusqu'au ruisseau de Pezul (de Pesuli) et englobant dans la juridiction de Milhac le manse
de la Dreyerie (mansum de la Ladraria) et de là, s'élevant à travers une certaine combe et
au moyen de bornes terminales anciennes vers le soleil levant jusqu'au lieu de
Sainte-Alvère, et comprenant dans la juridiction de Milhac l'aire ou sol de la
Martinia, existant près du lieu de Ste-Alvère.
Et, de là, en
descendant, en suivant la ligne d'antiques bornes en pierre (qu'on dit
aujourd'hui arrendicata) jusqu'au ruisseau de La Loyra (aujourd'hui La Louyre)
ruisseau qui descend des sources de Ste Alvère et s'écoule vers Longa ; on
comprend ainsi dans la juridiction de Milhac tout le territoire et même le
repaire de Ratavolp (Etat maj. Rateboul au sud-ouest de Ste -Alvère), de Gourgues
Dict. top. Ratebouil), le moulin de la Maugorsia et les manses de Costa
Rausta (Et. maj. Costeraste, commune
de Sainte-Alvère), de Gourgues Dict. top. Coste-rauste?) jusqu'à la combe del Conduch et le chemin qui va du castrum
de Longa vers le castrum
de Milhac.
C'est
dans cette partie que se trouve le bois ou forêt ancienne du castrum
de Milhac, appelée
forêt de Las Bitas[93] ; elle contient 10 sesterées et plus ; là, sont de grands arbres vieux,
elle est en partie
dans la paroisse de Ste-Alvère de la juridiction de Milhac et est
entourée, dans sa plus grande partie, de fossés, de bornes et de chaussées.
Le chemin
public qui va de Ste-Alvère vers Bergerac traverse le bois lui-même.
Ce bois
ou forêt confronte avec les possessions d'un certain Raymond de Milhac, vers le
midi, avec le tenement de Lesparra et avec le tenement des fiefs du seigneur archevêque de Costeraste et avec les
domaines d'un certain Pierre Neger, et avec les terres de Gerald Cupens, qui
sont dans le tenement de la Esperta, du côté de Ste-Alvère ; et ces
confrontations sont rapportées dans les terriers anciens du seigneur archevêque
de Bordeaux.
Et de là la juridiction
de Milhac confronte, en comprenant le manse de la Sparra, et vers le soleil
couchant, avec les terres des gens de Grand Castang, suivant les bornes
anciennes, avec la fontaine del Buc, fontaine qui est sur le plateau, près le
lieu de Vicq ; et, en descendant, suivant les boules anciennes en comprenant la
paroisse de St-Maximin et une certaine combe jusqu'au ruisseau de Draynud, elle
comprend le repaire de la Rue et l'église de Drayaud et va jusqu'à la Dordogne,
elle confronte avec le fleuve en comprenant la moitié du fleuve, avec la moitié
du port de Badefol et des ports anciens de Mauzac et avec le port de Milhac en
son entier.
Cette confrontation est
confirmée par la voix publique et les traditions des anciens, et en certains
points, par les documents anciens »[94].
Ainsi,
d'après la description que Philiparie en fait, la châtellenie de Milhac ne
laissait pas que d'avoir quelque importance; elle venait après les châtellenies
de Belvès et de Bigaroque, était en valeur très supérieure à -celle de Couze.
Mais les droits
de l'archevêque paraissent avoir subi pendant les XIVe et XVe
siècles un grave contrecoup des événements malheureux du pays.
Philiparie,
après avoir constaté qu'à l'origine, l'archevêque avait de nombreux fiefs dont
il recevait l'hommage, déclare que, de son temps, personne ne faisait d'hommage
pour fiefs de la dite châtellenie ; aussi, en 1489, tous les fiefs nobles
furent déclarés en état de commise pour défaut d'exécution des devoirs dûs par
les vassaux « pro
deveriis non factis eidem domino », comme on le voit dans les registres
et papiers de Philiparie[95].
Aussi ne faut-il
pas s'étonner de trouver de nombreuses mentions de procès entamés entre le
seigneur et ses vassaux, et de nombreuses usurpations faites à son préjudice
par les vassaux eux-mêmes ou par les seigneurs voisins.
1°
Le seigneur de Badefol et ses gens prirent possession du port de Badefol
appartenant au seigneur archevêque, d'après la coutume et l'usage du fleuve de
Dordogne[96].
Un
débat s'engagea sur ce point, et une transaction fut faite entre le seigneur
abbé de Cadouin, propriétaire du castrum de Badefol et
Philiparie, procureur de l'archevêque de Bordeaux ; les pièces du procès sont
dans les archives de l'archevêque de Bordeaux[97].
2° Un procès a
été engagé, relativement au port de Mauzac, entre le procureur du seigneur
Artus de Montauban, archevêque de Bordeaux, et Richard de Gontaut, chevalier,
alors seigneur de Badefol[98] .
Le
seigneur archevêque de Bordeaux avait, en sa possession, paisiblement le port
de Mauzac; en 1497 il l'affermait pour l'une et l'autre rive ; le dit de
Gontaut[99], par violence,
le dépossédait, l'en dépouillait et un certain nombre de personnes, en défendant
les droits de l'archevêque, furent blessés ; le procureur de l'archevêque
sollicita des lettres à la chancellerie royale; l'exécution en fut faite par
Bertrand Tustal[100] , bachelier en
droit, lieutenant subrogé du sénéchal du Périgord (et aujourd'hui président à
la Cour royale du Parlement de Bordeaux), et l'archevêque réintégré dans ses
droits. Mais le dit chevalier en appela et porta l'affaire au Parlement de
Bordeaux.
Le procès ne fut
pas suivi, et l'archevêque fut frustré dans ses droits et sa possession ex negligencia
suorum officiariorum, par la négligence de ses officiers. Les
pièces du procès ont été confiées à Me Ludovic Ravelin, procureur au Parlement
pour l'archevêque de Bordeaux[101].
3°
Le seigneur abbé de Cadouin met obstacle à la possession de l'archevêque sur le
port ancien de Milhac[102].
4° Le seigneur
préposé de Trémolac cherche à s'emparer du territoire de Milhac, jusqu'au bord
de la garenne et de la juridiction entre la fontaine de Lalbar et le chemin qui
va de Trémolac vers Pezul et la dite garenne.
Le
procès est pendant au Parlement de Bordeaux entre le procureur du seigneur
archevêque et le dit préposé de Trémolac et petie sunt in
sacco tradito dicto Ravelin longe diu et nullus recitat [103].
5° Un procès est
pendant devant le Parlement entre le procureur du seigneur archevêque de
Bordeaux, demandeur et exerçant des poursuites contre les gens du tenement de
La Ladraria (Et. major La Dreyerie), par. de Pezul,
en vue du paiement du commun et le seigneur
de Turenne, seigneur de Limeuil, appelant; les pièces du procès ont été livrées
à Me Ravelin.
Le
seigneur Blaise de Grêle, archevêque de Bordeaux, affirmait avoir juridiction
sur le manse de la Dreyerie, et maintenant le procès est en suspens. Et comme
il y a environ dix ans, les officiers du seigneur de Limeuil et de Clarens
(forme moderne Clérans) avaient tenu, à nouveau pour la deuxième fois, leur
Cour de justice à Milhac, à l'occasion de la garenne dépendante du castrum, le débat fut
engagé; les seigneurs de Limeuil et de Clérans furent ajournés au Parlement ;
les pièces sont entre les mains de Ravelin, on ne suit pas l'affaire, et le
seigneur de Clérans espère justifier sa prise de possession de Clérans, en même
temps que celle de la terre de Milhac.
6° Il y a un
autre procès depuis fort longtemps commencé entre le dit seigneur archevêque de
Bordeaux et noble Adhémar de Lostange, seigneur de Sainte-Alvère et ses gens,
sur la juridiction d'un certain territoire, existant entre le bois ou forêt de
Las Bitas et l'aire ou place de la Martinie, située près de l'église de
Sainte-Alvère; et aussi à l'occasion du bois ou forêt de Las Bitas et sur la
juridiction ou fondalité et utilité des manses de Costa et Rausta, du moulin de
la Maugorsia et sur la juridiction et le fief de Ratavop (Et maj. Ratebout).
Le
procès est en suspens au Parlement ; les parties furent appointées et admises à
faire des enquêtes ; celles-ci devaient être faites et par le seigneur de
Sainte-Alvère et par le seigneur archevêque de Bordeaux.
Le
seigneur archevêque peut prouver son droit sur la forêt de Las Bitas, au moyen
de ses livres terriers anciens, par l'usage et par les dires des anciens ; il
peut établir son droit au moulin de La Maugorsia et aux manses de Coste Raste,
au moyen de douze actes anciens, livrés en un sac par Philiparie au procureur
de l'archevêque de Bordeaux et son représentant au Parlement ; il peut baser
son droit sur ses anciens livres terriers et sur quatre actes anciens, relatés
dans un protocole ancien de notaire, extraits qui sont dans les mains de Me
Jehan de Valminiot de Plazac, et sur les actes relatifs à Ratebout et par les
enquêtes et par les dires des anciens.
7° Le seigneur de Turenne occupe la
juridiction dans les manses de la Raulia et de la Saghia, au-delà de la fontaine
del Buc, prés du lieu de St-Maximin (St-Maime de Rozens), comme
dépendances de la juridiction de Clérans ; cette occupation a duré longtemps,
sans contestation, sans que personne élevât de protestation.
Et il faut bien
remarquer que ce même seigneur de Limeuil et de Clérans, après avoir pris le
dit castrum
de
Milhac et l'avoir détruit, ce même seigneur, qui s'intitulait seigneur de
Limeuil, ajouta à son nom celui de ses autres châteaux, et s'intitula seigneur
de Milhac.
Et j'ai souvenir qu'en l'an du Seigneur mil quatre
cent cinquante deux, moi Guilhem de Philiparia, prêtre, alors substitué à M[104]
Jean de Trilheries, procureur des seigneurs Annet de la Tour[105] et Pierre[106] de Beaufort[107], cousins, alors comtes de Beaufort et vicomtes de
Turenne, et aussi seigneurs de Limeuil, de Miremont et de Clérans s'intitulaient aussi seigneurs de Milhac ; alors, ils
occupaient le castrum et
la châtellenie de Milhac, et ils les avaient occupés longtemps au temps des
guerres et, après l'année 1454, ils restituèrent le castrum
de Milhac au seigneur
archevêque de Bordeaux, Pierre Berland[108] .
Mais
cette restitution ne lut pas complète[109] .
8° Le seigneur de
Longa occupait, dans la juridiction de Milhac, plusieurs fiefs, sans juste
cause.
9°
Les officiers royaux, comme consuls de Lalinde, occupent la juridiction dans le
repaire de La Rue et près de l'église de Drayaud et dans le repaire de Drayaud
entre le ruisseau de Drayaud, et le fleuve de Dordogne, le port de Badefol et
les terres dépendantes de Mauzac ; et cependant la terre, près de l'église de
Drayaud, est pour partie du fief du dit archevêque de Bordeaux, en dessous du
chemin de Lalinde et près le ruisseau, le procès, à leur occasion, est pendant
au Parlement entre le procureur du dit archevêque de Bordeaux et les officiers
royaux et consuls de Lalinde, défendeurs ; les pièces sont dans le sac remis à
Me Ravelin, procureur en Parlement du dit seigneur archevêque[110] .
Il
semble devoir résulter de là que les droits de l'archevêque dans les châtellenies
de Milhac et de Couze furent considérablement diminués; ils n'étaient plus, au
moment de la rédaction du cartulaire, ce qu'ils auraient dû être et ce qu'ils
avaient été antérieurement; cependant les documents des archives de
l'archevêché permettent d'affirmer que la situation des archevêques de
Bordeaux, en tant que seigneurs, s'était bien améliorée dans la suite, et nous
les trouvons en possession dans ces châtellenies de droits importants en fiefs,
censives, rentes et autres droits ; nous indiquons, en note, les principaux
documents concernant nos châtellenies de Couze et de Milhac[111].
Tels
sont les renseignements que notre cartulaire de Philiparie fournit sur les
possessions des archevêques de Bordeaux en Sarladais. Il nous a paru
intéressant de les présenter méthodiquement, et quelles que soient les lacunes de notre travail,
il nous semble que celui-ci ne sera pas
à fait inutile.
A. Vigié.
Carte jointe :